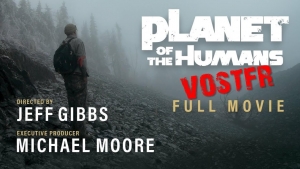Flash info
- ITV MATINALE DU LUNDI 14 AOÛT 2023 AVEC MOUHAMED KANDJI
- MISSION CONJOINTE SENEGALO-MAURITANIEN DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UN COMITE MIXTE SENEGALO-MAURITANIEN POUR LE…
- COP 27 EGYPTE (SHARM EL CHEIKH) : MOBILITE URBAINE DURABLE Après le TER, Le Bus Rapid…
- COP 27 EGYPTE (SHARM EL CHEIKH) JOURNEE DU SENEGAL Les défis majeurs de la Contribution Déterminée Nationale…
- Urgence environnementale dans deux localités du Chili : 75 personnes intoxiquées, dont une majorité d’enfants, au dioxyde…
- Les pays les moins avancés réclament des réductions d'émissions et des moyens financiers pour faire face aux…
- Les pays les moins avancés réclament des réductions d'émissions et des moyens financiers pour faire face aux…
- Les projets d'extraction causent des dommages irréparables aux cultures, aux langues et aux vies autochtones
BIODIVERSITÉ : SYNTHÈSE ET ANALYSE EXCLUSIVE DU 7E RAPPORT MONDIAL DE L’IPBES Spécial
L’IPBES est l’équivalent du GIEC pour la biodiversité. Il publie ce 6 mai 2019 un rapport inédit sur l’état de la biodiversité dans le monde, fruit de 3 ans de travail. Si les chiffres du déclin de la biodiversité sont alarmants, la communauté scientifique mondiale maintient qu’il est possible d’enrayer cette perte si les États prennent des mesures de protection ambitieuses.
La France accueille à Paris du 29 avril au 4 mai la 7e séance plénière de l’IPBES, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (l’équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité). Sous l’égide de l’ONU, 150 scientifiques de 50 pays, épaulés par plus de 300 experts, travaillent depuis trois ans à la réalisation d’un rapport sur l’état mondial de la biodiversité. Ils ont ainsi synthétisé quelques 15 000 références scientifiques et sources gouvernementales. Le rapport s’appuie aussi sur les savoirs autochtones et locaux, ce qui est inédit en termes de méthodologie à ce niveau.
C’est le premier travail de ce type à l’échelle mondiale en 15 ans. Ce rapport, rendu public le 6 mai, est extrêmement important, car il servira de document de référence pour l’élaboration du futur cadre mondial pour la biodiversité post-2020. Celui-ci sera défini par l’ensemble des États à l’occasion de la COP15 biodiversité qui aura lieu en Chine l’année prochaine. Cet évènement sera au moins aussi important pour la biodiversité que la COP21 pour le climat, car il donnera une orientation pour les 10 années à venir.
Le rapport montre globalement les relations entre les trajectoires de développement économique et leurs impacts sur la nature. Il propose aussi un éventail de scénarios possibles pour les décennies à venir, dont la radicalité politique est inédite à ce niveau, ce qui témoigne de l’urgence de la situation.
Dans cette synthèse, nous allons présenter les principaux résultats chiffrés que contient la version longue du rapport aux décideurs, puis un résumé des principales orientations proposées par le rapport ainsi qu’une première critique qui porte sur leur caractère parfois paradoxal.
UNE CRISE INÉDITE, ET LES IMPACTS SUR L’HUMANITÉ SE FONT DÉJÀ FORTEMENT SENTIR
La disparition de la biodiversité est 1000 fois supérieure au taux naturel d’extinction des animaux. Nous traversons donc la sixième extinction de masse des espèces, la dernière en date étant celle des dinosaures, il y a 65 millions d’années. Mais la crise actuelle est 100 fois plus rapide que la dernière, et exclusivement liée aux activités humaines.
GLOBALEMENT :
– Un quart des 100.000 espèces évaluées est déjà menacé d’extinction, sous pression de l’agriculture, de la pêche, de la chasse, ou encore du changement climatique. C’est une portion minime des 8 millions d’espèces estimées sur Terre (dont 5,5 millions d’insectes), mais nous pouvons néanmoins logiquement extrapoler ces chiffres à partir de ceux dont nous disposons déjà. Une accélération rapide imminente du taux d’extinction des espèces, animales et
végétales, est attendue par les scientifiques : un million supplémentaire sera menacé, dont la plupart durant les prochaines décennies.
– 75 % du milieu terrestre est sévèrement altéré à ce jour par les activités humaines, et 40 % du milieu marin.
– Depuis 1900, l’abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des grands habitats terrestres a diminué d’au moins 20 %, avec évidemment de fortes disparités régionales.
– On estime que 10 % des espèces d’insectes sont menacées, mais leur biomasse totale chute beaucoup plus rapidement.
– Au moins 680 espèces de vertébrés ont disparu depuis le 16e siècle.
Le rapport souligne que si les tendances actuelles en termes de biodiversité se poursuivent, cela va également freiner les progrès en vue d’atteindre les pour 2030 dans 80 % des cas où les cibles ont été évaluées. Nous parlons là des objectifs de réduction de la pauvreté, d’accès à la santé, à l’eau, l’urbanisation, le changement climatique, etc. La perte de biodiversité est donc non seulement un problème environnemental, mais aussi un enjeu lié au développement social, et à la lutte contre le changement climatique.
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, CATALYSEUR DE LA PERTE DE BIODIVERSITÉ
– Le changement climatique pourrait être à l’origine des menaces de disparition sur près de la moitié des mammifères terrestres et sur près d’un quart des oiseaux.
Le nombre d’espèces exotiques envahissantes a augmenté d’environ 70 % depuis 1970 en moyenne, tant à cause de la multiplication des échanges commerciaux (multipliés par 10 sur la période) que du réchauffement climatique.
– Même avec un réchauffement de la planète de 1,5 à 2 degrés, la majorité des aires de répartition des espèces terrestres devraient se contracter de manière importante.
– Nous avons réchauffé la planète de 1,1°C depuis l’ère préindustrielle. Le niveau des océans s’est élevé de 21 cm depuis 1900 (3 mm par an désormais). Or, les milieux naturels que sont les océans, sols et forêts, absorbent environ 60 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique.
Les émissions ont doublé depuis 1980, ce qui a fait augmenter la température moyenne de la planète d’au moins 0,7 degré.
– 8 % des émissions totales proviennent du tourisme (transport et alimentation), en très rapide augmentation.
L’AGRICULTURE, SOUVENT SYNONYME DE DÉSASTRE ENVIRONNEMENTAL
– Plus d’un tiers de la surface terrestre du monde et près de 75 % des ressources en eau douce sont maintenant destinées à l’agriculture ou à l’élevage. 12 % des terres émergées non couvertes par les glaces sont utilisées dans le monde pour la production agricole et 25 % pour les pâturages.
– La valeur de la production agricole a augmenté d’environ 300 % depuis 1970, mais la dégradation des sols a réduit de 23 % la productivité de l’ensemble de la surface terrestre mondiale. De plus, 75 % des plantes cultivées sont confrontées au risque de disparition des pollinisateurs.
– En agriculture, environ 10 % de toutes les races de mammifères domestiquées avaient disparu en 2016 en raison de la standardisation des élevages, de l’abandon de variétés moins productives. C’est une perte de diversité génétique qui rend l’élevage moins résilient aux maladies, et généralement moins adaptée aux conditions locales. Ce rythme connaît une accélération.
– 100 millions d’hectares de forêts tropicales ont été perdus entre 1980 et 2000, principalement en raison de l’augmentation de l’élevage du bétail en Amérique latine (environ 42 millions d’hectares) et des plantations en Asie du Sud-Est (environ 7,5 millions d’hectares, dont 80 % destinés à l’huile de palme). Environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre sont causées par ce défrichement.
– 68 % des capitaux étrangers qui vont aux secteurs du soja et de la viande bovine amazonienne transitent par des paradis fiscaux.
– 29 % des agriculteurs pratiquent une agriculture durable dans le monde, ce qui représente 9 % de toutes les terres agricoles.
– Le soutien financier fourni par les pays de l’OCDE à un type d’agriculture potentiellement nocif pour l’environnement monte à 100 milliards de dollars par an (base 2015).
L’URBANISATION ET L’ARTIFICIALISATION DES TERRES, CAUSE DE PERTE DE BIODIVERSITÉ RAPIDE
– Les zones urbaines ont plus que doublé depuis 1992. Elles augmentent plus vite que la population mondiale.
– Plus de 500 000 espèces terrestres ont désormais un habitat insuffisant pour leur survie à long terme, sauf si leur habitat est restauré.
– On compte plus de 2 500 conflits dans le monde pour les combustibles fossiles, l’eau, la nourriture et la terre.
L’EXTRACTION DE RESSOURCES FORESTIÈRES ET MINIÈRES, UN PHÉNOMÈNE QUI S’ACCÉLÈRE.
60 milliards de tonnes de ressources renouvelables et non renouvelables sont maintenant extraites chaque année dans le monde. Une quantité qui a presque doublé depuis 1980.
– La consommation mondiale de ressources par habitant a augmenté de 15 % depuis 1980, et la population a plus que doublé depuis 1970.
– La pollution par les plastiques a été multipliée par dix depuis 1980 et environ 300 à 400 millions de tonnes de métaux lourds, solvants, boues toxiques et autres déchets issus des sites industriels sont déversés chaque année dans les eaux du monde.
– La récolte de bois brut a augmenté de 45 % et 2 milliards de personnes l’utilisent comme combustible pour répondre à leurs besoins en énergie primaire.
– 50 % de l’expansion agricole a eu lieu au détriment des forêts, dont la superficie n’est plus que de 68 % de celle qu’elle était à l’époque préindustrielle.
110 millions d’hectares de forêts ont été plantés en plus de 1990 à 2015, soit presque deux fois la superficie de la France. Une cadence qui s’accélère notamment grâce aux efforts de l’Inde et de la Chine.
– Les subventions mondiales pour les combustibles fossiles représentent quelque 345 milliards de dollars par an et entraînent des coûts globaux de 5 000 milliards de dollars (santé, détérioration des habitats…).
LES COURS D’EAU ET LES OCÉANS, DES MILIEUX PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES
– 55 % des océans sont exploités par la pêche industrielle et on estime qu’un tiers des stocks de poissons marins sont surexploités, 60 % le sont au maximum du niveau durable et seulement 7 % à un niveau très durable.
Plus d’un tiers des prises de poissons dans le monde sont illicites ou non déclarées (2011) et 70 % des bateaux impliqués dans cette fraude sont financés à travers des paradis fiscaux.
– La diminution des herbiers marins, essentiels pour les animaux marins et pour séquestrer du carbone, est de 10 % par décennie depuis les années 1970. De leur côté, les récifs coralliens ont reculé de moitié depuis 1900 et les mangroves de 75 %. Ces milieux sont pourtant de vraies pouponnières pour les poissons.
– Plus d’un tiers de tous les mammifères marins et plus de 40 % des oiseaux marins sont menacés.
– À cause du changement climatique, la biomasse de poisson pourrait diminuer de 3 à 25 % en fonction des scénarios, et ce indépendamment de la pêche.
À cause des engrais, 400 zones mortes se sont développées dans les océans, ce qui représente environ 245.000 km2, soit une superficie totale supérieure à celle du Royaume-Uni, en expansion rapide.
– Plus de 40 % des espèces d’amphibiens sont menacées d’extinction, ils ont pourtant un rôle essentiel dans la régulation des insectes comme les moustiques. De fait, les zones humides disparaissent actuellement trois fois plus vite que les forêts et près de 90 % d’entre elles ont été perdues depuis le 18ème siècle.
– 80 % des eaux usées mondiales rejetées dans l’environnement ne sont pas traitées, surtout en Asie et en Afrique.
DES MESURES DE PROTECTION POTENTIELLEMENT EFFICACES : QUELQUES EXEMPLES
– Grâce aux investissements pour la conservation réalisés de 1996 à 2008, on a réduit le risque d’extinction pour les mammifères et les oiseaux de d’environ 29 % dans 109 pays.
– Plus de 107 espèces d’oiseaux, de mammifères et de reptiles très menacées sont de nouveau en croissance grâce à l’éradication des espèces mammifères envahissantes comme les rats ou les opossums dans les îles.
– Grâce à des programmes spéciaux, au moins 6 espèces d’ongulés (mammifères à sabots) qui risquaient de disparaître ont survécu en captivité et peuvent désormais recoloniser leurs milieux.
RÉALITÉ DE LA CRISE CONTRE VŒUX PIEUX : DES PRÉCONISATIONS AMBIVALENTES
L’IPBES recommande de mettre en place une planification intégrative en faveur de la biodiversité, de diminuer nos sources de pollution et les conséquences environnementales de la pêche, de coordonner les législations locales, nationales et internationales, et par conséquent, de réduire notre consommation. Il nous faudrait également « employer des régulations et des politiques publiques » et « internaliser les impacts environnementaux », c’est-à-dire prendre acte de ceux-ci et agir en conséquence sur le plan économique.
Ce nouveau rapport souligne la nécessité de changer les de modes de production et de développer des chaînes alimentaires moins nocives pour la nature. Il suggère également qu’il nous faudrait adopter un autre modèle politique et économique, enjoignant à des « changements transformateurs dans les domaines de l’économie, de la société, de la politique et de la technologie » – en d’autres termes, à un changement systémique. Cependant, on remarquera que le vocabulaire même de l’IPBES demeure fondamentalement tributaire de la pensée capitaliste néolibérale, intrinsèquement écocide et biocide. Ce rapport ne se prive pas d’employer les termes de management de la nature, de conservation et de restauration. Nous ne pourrons cependant pas répondre aux impératifs de la sixième extinction de masse en promouvant la vision d’une nature-musée, dans la droite lignée d’une taxonimie taxidermique qui nie au vivant ses caractéristiques intrinsèques. Tout véritable changement doit s’appuyer sur un constat qui prend en considération les origines politiques, économiques et culturelles de la crise écologique. Parmi les recommandations figurent des « modèles économiques alternatifs » qu’il faudrait expliciter, en particulier dans leur faisabilité pratique.
On y lit également qu’il serait nécessaire de reconnaître « l’expression de différents systèmes de valeurs », et de « différents types de savoirs ». Ceux des communautés autochtones figurent au premier plan. L’IPBES consacre plusieurs paragraphes au rapport qui lie les communautés indigènes à la nature, enjoignant les États à les prendre davantage en considération dans « la gouvernance de l’environnement », sans toutefois mettre en lumière les raisons idéologiques et culturelles qui permettent à ces peuples d’échapper à l’attitude destructrice occidentale moderne. Lynn White, dans un article intitulé « The historical roots of our ecological crisis » publié dans Science en 1967, soulignait la responsabilité des religions abrahamiques dans la situation actuelle, du fait de leur vision désastreuse de la nature comme propriété humaine instrumentalisable, par opposition aux cultes païens pré-chrétiens antiques dont l’éthique et l’axiologie étaient similaires aux approches indigènes contemporaines. Les peuples autochtones partagent un point commun qui leur a valu le mépris des évolutionnistes ethnocentrés : ils contestent la notion même de propriété vis-à-vis de la nature, qu’ils considèrent comme un tout indivisible, un écosystème global dans lequel l’homme doit s’intégrer, et non l’inverse. Ce faisant, la domination technique de la nature jusque dans ses excès, critère d’avancement d’une civilisation en Occident, est à leurs yeux un symptôme de retard culturel. Reconnaître la capacité supérieure des peuples autochtones à entretenir un rapport harmonieux plutôt que conflictuel à la nature revient nécessairement à questionner le nôtre.
Pour Robert Watson, président de l’IPBES et ancien président du GIEC : « La santé des écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres espèces, se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. […] Qu’il s’agisse des jeunes à l’origine du mouvement #VoiceforthePlanet ou des grèves scolaires pour le climat, il y a une vague de prise de conscience qu’une action urgente est nécessaire si nous voulons assurer un avenir à peu près soutenable. » Un témoignage de soutien à des mouvements sociaux pour le climat qui se placent de plus en plus clairement en dissidence par rapport à leurs gouvernements respectifs en dit également long sur le degré d’urgence qui pousse le milieu scientifique vers le politique.
CONCLUSION
Aucun des 20 objectifs précédemment définis en 2010 par l’ONU lors de la convention d’Aichi, au Japon, qui visaient à réduire au moins de moitié le rythme d’appauvrissement biologique en 2020, ne sera atteint d’après les rédacteurs du rapport. Il nous faudra donc relever fortement l’ambition des objectifs de la prochaine décennie, qui seront décidés sur la base du rapport de l’IPBES l’année prochaine en Chine. Au-delà des grandes déclarations, le problème reste le même que pour les objectifs climatiques : le caractère contraignant, sur le plan juridique, politique et économique, des recommandations. Or, dans un contexte global de crise du multilatéralisme, le cynisme est plutôt de mise. Aucun ministre français ne s’est déplacé pour la cérémonie d’inauguration de cette importante plénière internationale, préférant, comme Monsieur Le Drian, faire lire son discours ou comme Monsieur De Rugy de différer le sien. Des discours politiques largement fondés sur la promotion de l’image de la France qui « soutient la démarche » de l’IPBES, sans piper mot sur la nécessaire régulation de l’activité économique pourtant prônée directement par les rédacteurs du rapport.
La perte de la biodiversité peut être appréhendée de manière morale, mais aussi de façon pragmatique : c’est cette biodiversité qui nous procure de la nourriture, de l’eau potable, de l’air, des médicaments et une grande part de notre énergie. Son déclin, en lien avec le changement climatique, a des conséquences directes sur chacun, qui se font déjà sentir et s’accentueront de manière drastique dans les prochaines années, où de nombreuses populations, notamment asiatiques, se verront déplacées à cause de la montée des mers.
Lorsque l’une d’elles disparaît, du point de vue humain, c’est aussi un potentiel modèle scientifique qui est perdu : le vivant a été perfectionné depuis 3,5 milliards d’années, ses formes et les substances qu’il produit dans un objectif précis sont parfaitement adaptées à un milieu donné. L’adaptation est aussi la faculté des êtres vivants à être le plus efficace possible avec le moins d’énergie possible, et c’est exactement ce dont l’humanité a besoin pour relever le défi climatique. Le biomimétisme est ainsi le futur de la technologie humaine, encore faut-il que l’humanité n’ait pas détruit ses modèles avant. Chaque espèce a un rôle à jouer dans l’équilibre global perturbé par l’activité humaine. Cet équilibre se fonde sur une loi d’interdépendance et de coopération à toutes les échelles. Les réactions en chaîne sont donc la règle au niveau écosystémique, le meilleur exemple en est la disparition des abeilles et des oiseaux, absolument fondamentaux dans la reproduction des plantes. Tant que nous ne comprendrons pas que notre survie dépend de celle de la nature qui nous nourrit, rien ne changera.
- Magazines
- Communiqués
- Plus lus
| CONTACTEZ-NOUS |
|
QUOI DE VERT, le Magazine du Développement Durable Adresse : Villa numéro 166 Gouye Salam ll - DTK Dakar - Sénégal TEL : 77 646 77 49 / 77 447 06 54 Email : redaction@quoidevert.org ; quoidevert@gmail.com
|