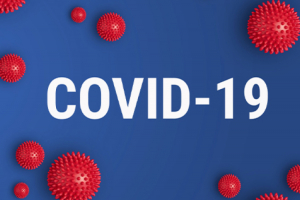Flash info
- ITV MATINALE DU LUNDI 14 AOÛT 2023 AVEC MOUHAMED KANDJI
- MISSION CONJOINTE SENEGALO-MAURITANIEN DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UN COMITE MIXTE SENEGALO-MAURITANIEN POUR LE…
- COP 27 EGYPTE (SHARM EL CHEIKH) : MOBILITE URBAINE DURABLE Après le TER, Le Bus Rapid…
- COP 27 EGYPTE (SHARM EL CHEIKH) JOURNEE DU SENEGAL Les défis majeurs de la Contribution Déterminée Nationale…
- Urgence environnementale dans deux localités du Chili : 75 personnes intoxiquées, dont une majorité d’enfants, au dioxyde…
- Les pays les moins avancés réclament des réductions d'émissions et des moyens financiers pour faire face aux…
- Les pays les moins avancés réclament des réductions d'émissions et des moyens financiers pour faire face aux…
- Les projets d'extraction causent des dommages irréparables aux cultures, aux langues et aux vies autochtones

Bernard KOR
Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.
Les pays développés ont également des avantages. Au lieu d'exporter des véhicules anciens et polluants, les États pourraient les envoyer dans des centres de recyclage, créant ainsi des emplois et mettant en place un système circulaire qui fournit des matières premières recyclées aux constructeurs automobiles. Et, à mesure que l'offre aux pays en développement diminue, les prix augmentent, ce qui incite financièrement les pays en développement à accroître leur propre capacité de production et jette les bases d'une transition éventuelle vers des systèmes de transport plus propres.
Des politiques claires stimulent également l'innovation et le progrès du secteur privé. Mark Carney, l'envoyé spécial des Nations unies pour le climat et la finance, a fait observer que le moratoire sur les moteurs à combustion interne dans l'Union européenne et au Royaume-Uni après 2030 signifie que l'industrie peut s'avancer dès maintenant et apporter les changements nécessaires.
"C'est exactement là que le secteur financier est le plus puissant. Car le secteur financier n'attendra pas 2030 pour s'adapter. Il va commencer à s'adapter dès maintenant. Il donnera de l'argent, des investissements et des prêts aux entreprises qui ont l'intention de prospérer dans ces environnements", a-t-il déclaré. Comme pour tous les défis environnementaux, le succès ne pourra être obtenu que par le biais d'une coopération mondiale. "Peu importe que les émissions climatiques soient émises aux Pays-Bas ou au Kenya. Elles comptent dans les émissions mondiales et les émissions mondiales du parc automobile mondial doivent être réduites à zéro d'ici 2050", a déclaré M. de Jong. "Quand il s'agit des changements climatiques, il n'est pas possible d'expédier un problème. Le problème demeure."
Certains pays africains ont travaillé avec des partenaires pour élaborer de nouvelles normes, avec l'aide du Fonds des Nations unies pour la sécurité routière, présidé par l'envoyé spécial des Nations unies pour la sécurité routière, Jean Todt, qui est également président de la Fédération internationale de l'automobile.
Ce travail a déjà porté ses fruits en Afrique de l'Ouest, où la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a adopté l'année dernière un ensemble complet de réglementations visant à introduire des carburants et des véhicules plus propres. Ces normes sont entrées en vigueur en janvier de cette année.
Des efforts sont actuellement déployés pour introduire des règles similaires en Afrique de l'Est, a déclaré M. de Jong, et l'Afrique du Sud a lancé un processus de consultation sur des normes harmonisées. "Je suis très optimiste quant au fait que, dans moins de cinq ans, nous pourrons disposer de normes harmonisées dans toute l'Afrique et que, dans moins de huit ans, le monde entier pourra introduire ces normes minimales, à quelques pays près", déclare M. de Jong, qui fait remarquer que des mesures doivent également être prises à l'autre bout de la chaîne d'approvisionnement. "Les exportateurs doivent également prendre leurs responsabilités. Si un véhicule n'est plus en état de marche dans un pays européen, il ne faut pas l'exporter, qu'il existe ou non une réglementation dans le pays importateur", dit-il.
À l'échelle mondiale, le secteur des transports est responsable de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Les émissions des véhicules sont également une source importante de particules fines et d'oxydes d'azote, qui sont des causes majeures de la pollution atmosphérique urbaine.
De nombreux véhicules d'occasion exportées ne sont pas conformes aux normes de sécurité ou d'émission dans leur pays d'origine, certains étant même dépourvus de pièces essentielles ou de dispositifs de sécurité, tels que les filtres à air. Dans l'idéal, ces véhicules seront rapidement éliminés dans le cadre de la transition mondiale vers la mobilité électrique mais, en attendant, les experts estiment que ce commerce doit être réglementé, notamment parce que le parc automobile mondial doublera d'ici à 2050 et que 90 % de cette croissance aura lieu dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
Beaucoup de ces véhicules usagés émettent des gaz d'échappement dangereux : les personnes sont exposées à des niveaux élevés de pollution atmosphérique. D'autre part, ces véhicules ne sont pas en état de marche, ce qui entraîne une augmentation des accidents et des décès.
Alors que de nombreux pays développés se sont engagés à éliminer progressivement les véhicules à essence et diesel au cours des deux prochaines décennies, la transition sera plus compliquée dans les pays en développement, où les vieilles voitures importées d'Europe, du Japon et des États-Unis sont souvent la seule option abordable.
Rob de Jong, chef de l'unité "Mobilité durable" du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), estime qu'il est impossible d'atteindre les objectifs d'émissions zéro fixés par l'accord de Paris sur les changements climatiques sans réglementer le commerce des voitures d'occasion.
"Au fil des ans, alors que la demande de voitures d'occasion abordables a augmenté dans les pays en développement, nous avons constaté une augmentation des exportations de véhicules polluants et obsolètes en provenance des pays développés. Ces problèmes sont tous interconnectés. Si nous voulons que le parc automobile mondial devienne électrique, il faut s'attaquer à ce problème dans le cadre de cette démarche", explique-t-il.
- L'adaptation, l'atténuation et le financement sont tous renforcés dans un équilibre complexe et délicat soutenu par toutes les parties.
- Après six ans de négociations acharnées, les points en suspens qui empêchaient la mise en œuvre complète de l'Accord de Paris sur les marchés du carbone et la transparence ont finalement été approuvés.
Les délibérations de la session actuelle de la COP, de la CMP et de la CMA se sont achevées ce samedi à Glasgow, un jour plus tard qu’initialement prévu. Le vaste ensemble de décisions, de résolutions et de déclarations qui constitue le résultat de la COP 26 est le fruit d'intenses négociations au cours des deux dernières semaines, d'un travail formel et informel acharné pendant de nombreux mois et d'un engagement constant, en personne et virtuellement, pendant près de deux ans. Le paquet adopté aujourd'hui est un compromis global qui reflète un équilibre délicat entre les intérêts et les aspirations de près de 200 parties aux instruments fondamentaux du régime international qui régit les efforts mondiaux contre les changements climatiques.
Sous la présidence britannique et avec le soutien du Secrétariat de la CCNUCC, les délégués ont forgé des accords qui renforcent l'ambition dans les trois piliers de l'action climatique collective.
L'adaptation a fait l'objet d'une attention particulière au cours des délibérations. Les parties ont établi un programme de travail pour définir l'objectif mondial en matière d'adaptation, qui identifiera les besoins collectifs et les solutions à la crise climatique qui touche déjà de nombreux pays. Le réseau de Santiago a été renforcé par l'élaboration de ses fonctions de soutien aux pays pour traiter et gérer les pertes et dommages. Enfin, le CMA a approuvé les deux registres des NDC et des communications sur l'adaptation, qui servent de canaux pour les informations destinées à l'inventaire mondial qui doit avoir lieu tous les cinq ans à partir de 2023.
Le financement a été largement discuté tout au long de la session et un consensus s'est dégagé sur la nécessité de continuer à accroître le soutien aux pays en développement. L'appel à au moins doubler le financement de l'adaptation a été salué par les parties. L'obligation de respecter la promesse de fournir 100 milliards de dollars par an des pays développés aux pays en développement a également été réaffirmée. Enfin, un processus visant à définir le nouvel objectif mondial en matière de financement a été lancé.
En ce qui concerne l'atténuation, l'écart persistant en matière d'émissions a été clairement identifié et les parties ont collectivement convenu d'œuvrer à la réduction de cet écart et de veiller à ce que le monde continue de progresser au cours de la présente décennie, afin que l'augmentation de la température moyenne soit limitée à 1,5 degré. Les parties sont encouragées à renforcer leurs réductions d'émissions et à aligner leurs engagements nationaux en matière d'action climatique sur l'Accord de Paris.
En outre, l'un des principaux résultats est la conclusion de ce que l'on appelle le règlement de Paris. Un accord a été conclu sur les normes fondamentales liées à l'article 6 sur les marchés du carbone, ce qui rendra l'Accord de Paris pleinement opérationnel. Cela donnera une certitude et une prévisibilité aux approches de marché et non de marché à l'appui de l'atténuation et de l'adaptation. Les négociations sur le cadre de transparence renforcé ont également été conclues, prévoyant des tableaux et des formats convenus pour comptabiliser et déclarer les objectifs et les émissions.
Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive d'ONU Climat a déclaré : Je remercie la présidence et tous les ministres pour leurs efforts inlassables tout au long de la conférence et je félicite toutes les parties d'avoir finalisé le livre de règles. C'est un excellent résultat ! Cela signifie que l'Accord de Paris peut désormais fonctionner pleinement pour le bénéfice de tous, aujourd'hui et à l'avenir.
Alok Sharma, président britannique de la COP26, a déclaré : Nous pouvons désormais affirmer avec crédibilité que nous avons maintenu en vie le seuil de 1,5 degré. Mais son pouls est faible et il ne survivra que si nous tenons nos promesses et traduisons nos engagements en actions rapides. Je suis reconnaissant à la CCNUCC d'avoir travaillé avec nous pour assurer le succès de la COP 26.
Les chefs d'État et de gouvernement et les délégués qui ont participé à la COP 26 ont apporté à la conférence une conscience aiguë de la gravité de la crise climatique à laquelle le monde est confronté et de la nécessité d'assumer la responsabilité historique de mettre le monde sur la voie de la résolution de ce défi existentiel. Ils quittent Glasgow avec une vision claire du travail à accomplir, des instruments plus solides et plus efficaces pour y parvenir et un engagement accru à promouvoir l'action climatique - et à le faire plus rapidement - dans tous les domaines.
Le rapport sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions 2021 montre que les CDN actualisées et les autres engagements en matière d'atténuation pour 2030 offrent 66 % de chances de parvenir à une augmentation de la température mondiale de 2,7 °C d'ici la fin du siècle. S'ils sont mis en œuvre efficacement et pris en compte dans les CDN, les engagements zéro émission nette peuvent réduire de 0,5°C la hausse de 2,7°C, se rapprochant ainsi de l'objectif de 2°C de l'Accord de Paris.
Oui, la pandémie COVID-19 a bien entraîné une baisse mondiale de 5,4 % du CO2 en 2020, mais il s'agissait d'une réduction temporaire. En 2021, les niveaux ne devraient être que légèrement inférieurs au record de 2019, ce qui portera la concentration de CO2 dans l'atmosphère à son niveau le plus élevé depuis deux millions d'années. Il est inquiétant de constater que seuls 17 à 19 % de la relance économique liée à la pandémie, soit 438 milliards de dollars sur 2 280 milliards, sont utilisés pour la relance verte et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sur cette relance verte, 90 % proviennent de sept pays, ce qui doit être étendu.
Toute augmentation de température approchant les 2,7°C serait une catastrophe pour l'humanité et de nombreuses espèces de la planète. Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), même une augmentation de 2°C aurait un impact majeur sur l'alimentation, la sécurité et la santé humaine.
Les insectes, indispensables à la pollinisation des cultures et des plantes, risquent de perdre la moitié de leur habitat à 1,5°C. Cette perte est deux fois plus importante à 2°C. Cette probabilité est deux fois plus élevée à 2°C. La fréquence et l'intensité des sécheresses, des tempêtes et des phénomènes météorologiques extrêmes augmenteront avec chaque augmentation de la température, comme nous le constatons déjà avec une augmentation de la température mondiale d'environ 1,2°C par rapport aux niveaux préindustriels.
- Magazines
- Communiqués
- Plus lus
| CONTACTEZ-NOUS |
|
QUOI DE VERT, le Magazine du Développement Durable Adresse : Villa numéro 166 Gouye Salam ll - DTK Dakar - Sénégal TEL : 77 646 77 49 / 77 447 06 54 Email : redaction@quoidevert.org ; quoidevert@gmail.com
|