Flash info
- ITV MATINALE DU LUNDI 14 AOÛT 2023 AVEC MOUHAMED KANDJI
- MISSION CONJOINTE SENEGALO-MAURITANIEN DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UN COMITE MIXTE SENEGALO-MAURITANIEN POUR LE…
- COP 27 EGYPTE (SHARM EL CHEIKH) : MOBILITE URBAINE DURABLE Après le TER, Le Bus Rapid…
- COP 27 EGYPTE (SHARM EL CHEIKH) JOURNEE DU SENEGAL Les défis majeurs de la Contribution Déterminée Nationale…
- Urgence environnementale dans deux localités du Chili : 75 personnes intoxiquées, dont une majorité d’enfants, au dioxyde…
- Les pays les moins avancés réclament des réductions d'émissions et des moyens financiers pour faire face aux…
- Les pays les moins avancés réclament des réductions d'émissions et des moyens financiers pour faire face aux…
- Les projets d'extraction causent des dommages irréparables aux cultures, aux langues et aux vies autochtones

Baye Salla Mar
La Société Anadarko va commencer à livrer du gaz naturel liquéfié à deux nouvelles compagnies asiatiques au Japon et à Taiwan. Ce sont les premiers partenariats noués par le groupe qui vient d’accepter l’offre de rachat par l'américain Occidental Petroleum à la place de son concurrent Chevron.
La société pétrolière et gazière Anadarko Petroleum Corp conclu -via l'une de ses joint-ventures de négoce de GNL- un accord avec la société japonaise JERA et la taïwanaise CPC Corp. La coopération porte sur la livraison de 1,6 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par année sur une période de 17 ans à compter de la mise en service commerciale du projet au Mozambique. C'est le premier contrat à long terme signé par l'américain Anakardo depuis son annonce, en fin de la semaine dernière de l'acception de l'offre de rachat par Occidental Petroleum Corp. Cette dernière a remporté la mise à 57 milliards de dollars soit une offre largement supérieure à celle proposée par Chevron.
« Cet accord de co-achat avec JERA et CPC réunit deux clients importants de fondations asiatiques et assurera un approvisionnement fiable en énergie plus propre pour répondre aux demandes croissantes du Japon et de Taïwan », a déclaré Mitch Ingram, vice-président exécutif de Deepwater & International chez Anadarko Exploration, dans un communiqué consulté par la Tribune Afrique.
Le groupe Anadarko se dit ainsi ravi de passer à l'étape suivante avec l'annonce attendue d'une décision d'investissement finale (FID) pour le projet de GNL au Mozambique, le 18 juin. Une nouvelle étape franchie dans le processus de financement du projet et l'obtention des approbations finales. Anadarko développe la première installation de GNL terrestre du Mozambique. À la fin de l'année 2018, Anadarko disposait des réserves prouvées d'environ 1,47 milliard de barils, faisant d'elle l'une des plus importantes sociétés indépendantes d'exploration et de production au niveau mondial.
Il y a une semaine, le major pétrolier et gazier français Total a conclu un contrat de 8,8 milliards de dollars avec Occidental Petroleum pour les actifs d'Afrique d'Anadarko, présent en Algérie, au Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud. La transaction à finaliser en 2020 est conditionnée par la conclusion de la part d'Occidental Petroleum de son projet d'acquisition d'Anadarko et à l'approbation des autorités compétentes. Anadarko est l'un des principaux partenaires de la Sonatrach en Algérie et du projet pétrolier Jubilee au Ghana.
Plusieurs Etats d'Afrique australe vont bénéficier d'une subvention d'une valeur globale de 10 millions d'euros de la République fédérale d'Allemagne accordée au Centre de services scientifiques pour le changement climatique et la gestion adaptative des terres en Afrique australe. Les fonds sont destinés à permettre à ces pays de combattre les répercussions du changement climatiques.
Le gouvernement allemand vient d'accorder une subvention de 10 millions d'euros au Centre de services scientifiques pour le changement climatique et la gestion adaptative des terres en Afrique australe (SASSCAL). Dans un communiqué, le Centre a indiqué que la mise en œuvre des projets grâce à cette subvention couvrira divers pays notamment l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, la Namibie et la Zambie, lesquels ont été sévèrement touchés par les effets du changement climatique résultant de la sécheresse, des inondations et des cyclones.
L'objectif de ce financement est de permettre à ces pays de faire face aux répercussions du changement climatique, a expliqué le SASSCAL, qui ajoute que la subvention contribuera dans ces pays à relever les défis du changement. « Le SASSCAL a obtenu un financement de 10 millions d'euros du ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche pour la recherche sur le changement climatique. Il sera mis en œuvre dans le cadre de la deuxième phase du portefeuille de recherche et développement des capacités, SASSCAL II. Le SASSCAL II s'appuiera sur les succès du SASSCAL », note le communiqué.
23,8 millions d'euros pour le SASSCAL I
Évoquant les performances dans le cadre du SASSCAL I, le Centre a rapporté que dans le cadre de cette première phase un total de 23,8 millions d'euros avait été utilisé en 2012 pour soutenir 88 projets de recherche. Ceux-ci étaient axés sur cinq thèmes à savoir, le climat, l'eau, la sylviculture, l'agriculture et la biodiversité ; et ont été conçus pour intégrer la recherche et le développement des capacités, a précisé le SASSCAL dans son communiqué.
En ce qui concerne l'implication des pays de la zone, à noter selon le SASSCAL, que plus de 500 personnes et plus de 80 institutions universitaires, gouvernementales et non gouvernementales participent aux tâches de recherche du SASSCAL I dans divers pays.
LaTribune
À l’occasion de la publication d’un Livre Blanc consacré à l'environnement et au développement durable au Maroc, Veolia et La Tribune Afrique présentent la stratégie du Royaume pour s'imposer comme « Green Hub » continental et les perspectives en la matière à l'horizon 2030 aussi bien pour le Maroc que pour l'Afrique dans son ensemble.
La Sierra Leone a procédé à une révision générale des contrats miniers avec à la clé l’annulation ou la suspension de plusieurs grands projets. Une décision contestée du gouvernement de Julius Maada Bio qui a également lancé un nouveau code national de gouvernance des entreprises pour attirer les investisseurs et diversifier l’économie.
Le gouvernement Sierra Léonais veut revoir à la loupe la conformité des entreprises minières aux normes locales. Pour ce faire, il a procédé à l'annulation ou à la suspension des licences de plusieurs grands projets miniers y compris les mines de fer de Tonkolili et de Marampa, selon des informations publiées vendredi par le Financial Times. Parmi les principales victimes de cette mesure figure le groupe chinois Shandong Iron and Steel. La société minière qui exploite le projet de minerai de fer Tonkolili, est l'une des principales entreprises présentes en Sierra Leone, alors que la compagnie Gerald Group dont le siège est à Londres est propriétaire des mines Marampa.
«Nous pouvons confirmer qu'une suspension temporaire de l'exploitation imposée par le ministère des Mines a expiré le 24 juillet 2019, à la suite de laquelle le ministère a demandé que nous n'exportions plus de matériel tant qu'il n'aurait pas vérifié le respect de nos normes minières», a déclaré Gerald Group. De son côté, le groupe Tonkolili a contesté cette décision devant la Cour suprême du pays, affirmant que les motifs justifiant l'annulation de ses licences étaient nuls, dans la mesure où la société s'est acquittée de l'ensemble des montants dus.
Réformes sous Julius Maada Bio
Elu à la tête du pas il y a un an, Julius Maada Bio a réexaminé les contrats d'exploitation minière. Il envisage ainsi des modifications de la loi régissant les activités minières du pays afin de permettre à ses habitants de mieux tirer profit des ressources issues du sous-sol. Par ailleurs, la Sierra Leone tente de sortir de sa dépendance au seul secteur minier. Pour rassurer les investisseurs des différents secteurs, le pays a lancé un nouveau code national de gouvernance des entreprises.
L'avant-projet du code publié en janvier 2019 met l'accent notamment sur l'éthique et la gouvernance dans le secteur et régit les droits des actionnaires et investisseurs. Il aborde également la composition, les comités, les process des réunions, l'égalité genre et les responsabilités du conseil d'administration, conformément aux principes de l'OCDE pour la gouvernance d'entreprise. Entre autres nouveautés, le document encadre aussi la nomination des CEO et les termes de leurs contrats, ainsi que plusieurs autres aspects clés comme l'encadrement du fonctionnement des entreprises familiales.
La Tribune
Les petites îles du Pacifique seront-elles sauvées ? Les experts pensaient qu'elles seraient englouties avec la montée des eaux liée au réchauffement climatique, mais une nouvelle étude vient donner un peu d'espoir. Elle établit, avec quelques nuances, que ces îles pourraient en fait modifier leur forme en même temps que le niveau des eaux augmente.
Les petites îles du Pacifique seraient plus résilientes que les scientifiques ne le pensaient jusqu’ici. C’est ce que vient de montrer une étude publiée le 5 juillet dans la revue Geology. Les chercheurs se sont intéressés aux îles comme Tuvalu, Tokelau et Kiribati, largement menacées par la montée des eaux et les catastrophes climatiques. Ces amas de sable dépassent à peine le niveau de l’océan.
Les îles s'élèvent en même temps que la montée des eaux
Les chercheurs ont utilisé un modèle réduit. "L’étude a simulé des niveaux de mer plus élevés et des vagues provoquées par des tempêtes allant jusqu’à quatre mètres de hauteur", expliquent dans une note les chercheurs de la School of Environment de l’université d’Auckland qui ont participé à l’étude. L'expérimentation s'est déroulée dans un canal de 20 mètres de long de l'université de Plymouth au Royaume-Uni.
Ils ont ainsi découvert que le point le plus haut de leur île artificielle avait gagné en altitude et que le reste s'était déplacé sur le récif corallien sous-jacent. Une analyse qui va à contre-courant de la thèse scientifique largement acceptée selon laquelle les atolls, ces îles en forme d’anneau constituées de récifs coralliens seraient donc noyées si une montée des océans survenait.
Des résultats à nuancer
"Les îles des atolls ne sont pas inertes sur le récif, le gravier et le sable qui la constituent se déplacent sur le récif corallien lui-même, de sorte que les terres se modifient en fonction des conditions environnementales", note Megan Tuck, auteure principale de l’étude. Les chercheurs émettent quelques réserves quant à leurs résultats car il s’agit d’une simulation sur modèle réduit et parce que certains éléments, comme la structure de l’île ou la végétation, n'ont pas été pris en compte dans l’expérimentation.
Mais le géomorphologue Murray Ford, coauteur de l’étude, souligne : "Les effets sur les différentes îles varieront de sorte que, même si certaines zones deviennent inhabitables, d’autres s’adapteront à la montée des eaux. Il incombera aux gouvernements et aux communautés de décider de la suite à donner, mais nous pensons que cette étude souligne le fait que la nature fournit un modèle d’adaptation et que les communautés insulaires devront peut-être s’en inspirer".
Novethic
1,8 million d'euros, c'est l'amende record que Bercy vient d'infliger à EDF pour des retards de paiement envers ses fournisseurs. Une sanction qui se veut avant tout exemplaire alors que moins d'une grande entreprise sur deux règle ses fournisseurs dans le délai imparti de 60 jours. Cela met en péril une PME sur quatre, en les privant d'une trésorerie de 19 milliards d'euros, selon l'Observatoire des délais de paiement.
Une amende record de 1,8 million d'euros a été infligée au groupe EDF pour des retards de paiement vis-à-vis de ses fournisseurs. Pour le ministère de l'Économie, à l'initiative de cette annonce, il s'agit d'adresser "un signal fort aux mauvais payeurs". Cette sanction, décidée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), est la plus élevée décidée à ce jour en France pour non respect des délais de paiement, en sachant qu'elle est proportionnée au montant de trésorerie immobilisé par l'entreprise.
L'objectif, au-delà de la question réputationnelle, est de "toucher au portefeuille des entreprises pour que le sujet ne soit pas considéré comme un sujet administratif de second rang", précise la secrétaire d'État à l'Économie Agnès Pannier-Runacher. Depuis la loi Sapin 2 de 2016 sur la transparence de la vie économique, les amendes encourues par les entreprises pour retard de paiement sont passées de 375 000 à deux millions d'euros. Un amendement introduit dans la loi Pacte autorise par ailleurs l'administration à publier dans la presse les noms des entreprises sanctionnées pour des défauts de paiement.
Plus de 3 000 fournisseurs payés en retard
Dans le cas d'EDF, dont l'État est actionnaire à hauteur de 83,7%, 13 416 (soit 10% des factures) n'ont pas été réglées dans les délais impartis entre mars et août 2017. Au total, "3 452 fournisseurs ont été payés en retard", indique le ministère, pour un montant global de 38,4 millions d'euros. "Les grands groupes sont souvent les mauvais payeurs, alors qu'a priori ce sont ceux qui ont le moins de problèmes de trésorerie", souligne Agnès Pannier-Runacher. "La lutte contre les retards de paiement est un enjeu de bon fonctionnement de l'économie."
EDF a annoncé prendre acte de la décision et assure qu'il "va continuer de renforcer ses procédures internes (...) afin que les démarches permettant le règlement des factures dans les délais soient comprises et bien suivies". Le géant de l'électricité va se voir retirer un label distinguant les entreprises qui entretiennent des relations durables et équilibrées avec leur fournisseurs, attribué en 2015.
Ces retards privent les PME de 19 milliards d'euros
L'énergéticien n'est pas le seul à s'être fait épingler ces derniers mois. L'Américain Amazon, le Chinois Huawei, le Suisse Nestlé Purina, mais aussi les Français Sephora, TechnipFMC, La Poste ou la Française des Jeux ont été condamnés à 375 000 euros d'amende. La sanction la plus importante concernait jusqu'ici le géant industriel allemand HeidelbergCement, via sa filiale Ciments Calcia, qui s'est vu adresser en mai une amende de 670 000 euros. Selon Bercy, 89 procédures de sanction ont été lancées, représentant "un montant potentiel de 11,4 millions d'euros".
Selon l'Observatoire des délais de paiement, moins d'une grande entreprise sur deux règle ses fournisseurs avant le délai de 60 jours prévu par la loi. Or, ces retards sont à l'origine des difficultés de trésorerie d'une PME sur quatre, les privant de 19 milliards d'euros de trésorerie. Les secteurs les plus touchés sont la construction, le soutien aux entreprises ou encore l'information et la communication.
AFP
20 millions d'habitants. Lagos, capitale économique du Nigeria, est une des plus grandes villes au monde. Elle n'abritait pourtant, dans les années 70, que deux millions de personnes. Sa croissance explose au point que l'Institut international pour l'environnement et le développement (Iied) estime qu'elle pourrait accueillir 85 à 100 millions d'habitants en 2100 et ainsi devenir la plus grande métropole au monde. Mais Lagos, construite au niveau de la mer, s'enfonce dans les eaux. Elle subit de plein fouet les effets de la crise climatique.
En 2050, la ville pourrait être submergée
Selon un rapport publié en mars par la Banque mondiale, l'océan Atlantique avance de un à quatre mètres par an sur les côtes ouest du continent, touchant ainsi le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Togo. La Nigerian Conservation Foundation (NCF) estime que Lagos pourrait être entièrement submergé d'ici 2050.
L'érosion des côtes de la région est aggravée par les tonnes de sable draguées pour construire les bâtiments nécessaire à la croissance de la population. Selon une étude réalisée par le gouvernement et que l'AFP a pu consulter, le fond marin serait percé de trous atteignant sept à huit mètres de profondeur et cela à seulement 25 mètres de côtes, fragilisant le littoral. "Plusieurs communautés ont déjà été emportées par les eaux", rapporte à l'AFP Chef Ede Dafinone, président de la NCF.
Des millions de tonnes de sables draguées
Mais il y a pire : l'Eko Atlantic. Il s'agit d'une île artificielle bâtie au large de Lagos. Cet aménagement doit devenir le "Dubaï de l'Afrique" et abriter à l'avenir le centre économique du pays, des buildings et des appartements de standing. Or plus de 100 millions de tonnes de sable ont été draguées pour fonder faire émerger cette terre, provoquant des effets dévastateurs sur le littoral.
"Eko Atlantic City, langue de terre à prix d'or gagnée sur l'Atlantique, est d'ores et déjà vendu à des promoteurs, et s'y profile un urbanisme inspiré de Dubaï, mais je reste sceptique : je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un jour l'océan reprendra ses droits", écrit la romancière nigériane Chimamanda Ngozi Adichie dans les colonnes de Courrier international.
Novethic
Démarrée au début du mois, la bioraffinerie de Total à La Mède, fonctionnant en partie avec de l'huile de palme importée, est déjà menacée. L'entreprise a déposé un recours contre l'exclusion de l'huile de palme de la liste des biocarburants et la suppression de son avantage fiscale. Elle s'estime victime de discrimination par rapport aux autres entreprises européennes, non soumises à la même disposition. Les ONG quant à elles rappellent le pouvoir néfaste de l'huile de palme sur la déforestation.
Total a déposé un recours auprès du Conseil d'État - qui l'a renvoyé devant le Conseil constitutionnel - contre l'exclusion des produits à base d'huile de palme dans la liste des biocarburants à compter du 1er janvier 2020. Le groupe a démarré sa bioraffinerie à La Mède (Bouches-du-Rhône), l'une des plus grandes d'Europe, début juillet. Celle-ci doit fonctionner en partie avec de l'huile de palme, faisant bondir les importations françaises de cette huile accusée de déforester les forêts primaires.
"Nous avons déposé auprès du Conseil d'Etat un recours contre le décret d'application de la disposition de la Loi de finances pour 2019 qui exclut les seuls produits à base d'huile de palme, même durable, de la liste des biocarburants", a indiqué à l'AFP une porte-parole du géant pétrolier et gazier. "Nous estimons que cette disposition de la loi française introduit une discrimination incompatible avec la Constitution française et le droit communautaire", a-t-elle ajouté.
"Pas vocation à faire tourner des usines à perte"
Total estime être victime de discrimination parce que la loi française est plus ambitieuse que la directive européenne. En effet, la Commission européenne n’a pas complètement fermé la porte à l’utilisation de l’huile de palme dans les carburants. Néanmoins, le texte prévoit explicitement la possibilité pour les États membres d’être plus ambitieux
Mais la disposition, votée par les députés à la mi-décembre, qui entraîne la suppression de l'avantage fiscal pour les biocarburants à base d'huile de palme, met de fait en cause l'équilibre économique et la compétitivité de la bioraffinerie de La Mède. "Je ne fais pas de chantage à l'emploi. Mais soyons clairs : ce n'est pas parce que Total est riche qu'il a vocation à faire tourner des usines à perte", avait mis en garde son PDG, Patrick Pouyanné, en début d'année. L'ensemble des activités du site représentent 250 emplois directs.
"Défendre l'indéfendable"
L'utilisation d'huile de palme importée est dénoncée par les associations de défense de l'environnement pour qui elle contribue à la déforestation en Asie du Sud-Est. Les ONG dénoncent aussi l'inefficacité des labels de certification et jugent que les entreprises ne peuvent pas contrôler la déforestation indirecte. "Total s’obstine à vouloir défendre l’indéfendable, seul contre tous. Une fois de plus, la réaction de l’entreprise est de vouloir remettre en cause la loi plutôt que de revoir son projet de bioraffinerie de La Mède" commente Sylvain Angerand, porte-parole des Amis de la Terre.
Selon Total, la bioraffinerie pourra traiter 650 000 tonnes par an et elle s'approvisionnera en huile de palme "durable et certifiée" à hauteur de 300 000 tonnes au maximum. L'entreprise avait déjà saisi le Conseil Constitutionnel le 21 décembre 2018 à l’issu du vote du projet de loi de finances 2019. La saisine avait alors été rejetée.
Novethic/AFP
- Magazines
- Communiqués
- Plus lus
| CONTACTEZ-NOUS |
|
QUOI DE VERT, le Magazine du Développement Durable Adresse : Villa numéro 166 Gouye Salam ll - DTK Dakar - Sénégal TEL : 77 646 77 49 / 77 447 06 54 Email : redaction@quoidevert.org ; quoidevert@gmail.com
|




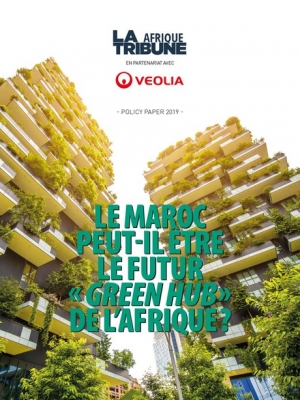

![[SCIENCE] LES PETITES ÎLES DU PACIFIQUE POURRAIENT FINALEMENT S'ADAPTER À LA MONTÉE DES EAUX](/media/k2/items/cache/dd34e32172fe0202ef287e574244e1d2_Generic.jpg)





































