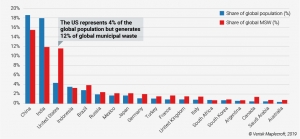Lorsqu'une méthode de restauration d'écosystème ayant fait ses preuves contribue également à réduire la pauvreté et à renforcer la résilience économique, souvent les gouvernements les soutiennent en tant que solution bénéfique à tous.
Le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le Kenya Forest Service, l'Institut de recherche sur la pêche et la marine du Kenya et ses partenaires ont récemment lancé le projet Vanga Blue Forests sur la côte kenyane, une initiative novatrice dont le but est d'échanger des crédits carbone issus de la conservation et de la restauration de la mangrove.
« L'ensemble de ce village, ainsi que d'autres villages voisins dépendent de la pêche. La forêt de mangroves est une véritable zone de reproduction pour les poissons », affirme le chef de Vanga, Kama Abdallah.
« Si les mangroves sont détruites, nous connaîtrons la faim », ajoute Mwasiti Salim, un habitant de Vanga.
En juin 2019, le plan de gestion participative de la Vajiki Community Forest Association a été lancé à Vanga, dans le cadre du projet soutenu par le Fonds des Nations Unies pour l'environnement dans le cadre du projet « Forêts bleues » du Fonds pour l'environnement (Global Environment Facility Blue Forests Project, en anglais) et du programme de petites subventions pour les récifs coralliens de l'Initiative internationale pour les récifs coralliens (International Coral Reef Initiative/UN Environment coral reefs small grants programme, en anglais).
Avec ce plan, les mangroves du comté de Kwale seront cogérées par le Kenya Forest Service et la Community Forest Association. ONU Environnement a contribué à élaborer le plan tandis que l'Institut de recherche sur la marine et les pêches du Kenya a fourni un appui technique à la communauté.
Le plan de gestion comprend également la vente de crédits carbone sur le marché volontaire du carbone, vérifié par la norme d'échange de carbone de Plan Vivo. Elle s'appuie sur le succès d'un projet similaire mené à Gazi, une communauté située à quelques kilomètres au nord, qui négocie des crédits carbone pour la mangrove sur le marché volontaire du carbone depuis 2012.
« À l'échelle mondiale, il s'agit de l'un des premiers projets qui négocie des crédits carbone issus de la conservation et de la restauration de mangroves », affirme Gabriel Grimsditch, expert dans les mangroves à ONU Environnement.
« Le projet préservera et restaurera plus de 4 000 hectares de mangroves dans le comté de Kwale et soutiendra les moyens de subsistance de plus de 8 000 personnes dans les communautés de pêcheurs de la région grâce à des initiatives de développement communautaire », ajoute-t-il.
Lilian Mwihaki de l’Institut de recherche sur la pêche et la marine au Kenya souligne les avantages du commerce du carbone : « Grâce à la vente de crédits carbone, les pêcheurs disposeront de fonds qu’ils pourront injecter dans la communauté. La communauté de Gazi a pu acheter des livres pour ses écoliers. Ils ont pu acheter du matériel pour leur hôpital. Ils ont été en mesure d’apporter de l’eau à leur communauté. »
Le lancement du projet s'est révélé être un événement de grande importance auquel ont assisté le secrétaire du Cabinet kenyan à l'Environnement, Keriako Tobiko, le conservateur en chef des forêts du Kenya, Julius Mwaura, le scientifique en chef de l'Institut de recherche sur la marine et la pêche du Kenya, James Kairo, et le président de l'Institut de recherche sur la marine et la pêche du Kenya, John Safari Mumba.
Les mangroves sont des écosystèmes rares, spectaculaires et prolifiques situés entre terre et mer. Elles abritent une riche biodiversité et constituent un habitat précieux pour la reproduction des poissons et des crustacés. Les mangroves constituent également une forme de défense côtière naturelle contre les épisodes de tempête, les tsunamis, l'élévation du niveau de la mer et l'érosion. Leurs sols sont des puits de carbone très efficaces, séquestrant de grandes quantités de carbone.
Pourtant, les mangroves disparaissent trois à cinq fois plus rapidement que les forêts, entraînant de graves impacts écologiques et socio-économiques. Les estimations actuelles indiquent que la couverture des mangroves a été réduite de moitié au cours des 40 dernières années.
« Les estimations de la superficie totale des mangroves dans le monde varient, mais se situent entre 12 et 20 millions d'hectares. Le projet Vanga ne couvre qu'un infime pourcentage de cette zone, mais étant donné leur caractère évolutif, il est possible de reproduire ce genre d'innovations dans le monde entier en y apportant des modifications locales », déclare Gabriel Grimsditch.
La Journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves, célébrée le 26 juillet, a été adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 2015.
Pour davantage d'informations, veuillez contacter Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Le sommet des Nations unies Action Climat se tiendra à New York le 23 septembre 2019 pour renforcer les ambitions, accélérer l'action sur l'urgence climatique mondiale et soutenir la mise en œuvre rapide de l'Accord de Paris sur les changements climatiques. Le Sommet de l'ONU Action Climat 2019 est organisé par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.
UN.ENVIRONMENT