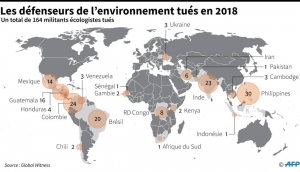Moins de deux mois après avoir annoncé sa volonté de planter des millions d'arbres, l'Ethiopie a déjà établi un nouveau record. En l'espace d'un jour seulement, le pays a réussi à mettre en terre plus de 350 millions d'arbres à travers son territoire, d'après le Premier ministre Abiy Ahmed qui avait planté fin mai le premier arbre pour affirmer le plan ambitieux de l'Ethiopie.
Au cours des prochains mois, le pays située sur la corne de l'Afrique entend en effet ajouter pas moins de quatre milliards d'arbres à sa végétation pour lutter contre la déforestation et le changement climatique. Ces arbres "vont aider à transformer nos environnements dégradés pour [favoriser] des vies saines et des écosystèmes fonctionnels", expliquait en juin dernier Abiy Ahmed repris par The Times.
Si l'Ethiopie recèle des écosystèmes et une biodiversité très riches, elle a perdu une grande partie de sa végétation. On estime qu'au XXe siècle, la couverture forestière représentait environ 35% de la surface du pays. Ce chiffre est aujourd'hui tombé à environ 12% selon les chiffres de l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Alors que la couverture forestière s'est réduite, les terres se sont également asséchées et sont devenues moins fertiles, exposant les 105 millions d'Ethiopiens à de potentielles famines. Le phénomène s'est en outre couplé aux feux de forêt et à l'impact négatif du changement climatique qui a favorisé les sécheressesdans de nombreuses régions du pays.
200 millions d'arbres plantés en 12 heures
C'est pour combattre la dégradation des écosystèmes que le gouvernement éthiopien a lancé sa vaste initiative de reforestation "Green Legacy" qui doit avoir lieu avant la saison des pluies, soit d'ici le mois de septembre prochain. Le 29 juillet dernier, se tenait ainsi la première opération d'envergure. L'objectif était d'atteindre les 200 millions d'arbres plantés en 12 heures, mais les chiffres auraient dépassé les attentes.
Sur Twitter, le ministre de l'Innovation et de la Technologie éthiopien Getahun Mekuria a affirmé que 353.633.660 arbres avaient été mis en terre en un jour. Un record qui bat les précédents établis en 2016 et 2017 par l'Inde qui avait planté respectivement 50 et 66 millions d'arbres en un jour. Il faut dire aussi que l'Ethiopie avait mis toutes les chances de son côté.
En plus de mobiliser la population via des vidéos promotionnelles appelant à planter et prendre soin des arbres, selon la BBC, les bureaux de certains services publics et ambassades ont été fermés pour permettre aux employés de prendre part à l'opération.
Planter un arbre oui, mais pas seulement
Interrogé par The Guardian, le Dr Dan Ridley-Ellis, spécialiste des arbres de l'Université Napier d'Édimbourg en Ecosse a expliqué : "Non seulement les arbres réduisent le changement climatique en absorbant le dioxyde de carbone de l'air mais ils ont aussi d'immenses bénéfices pour combattre la désertification et la dégradation des sols, en particulier dans les pays arides".
Comme l'a souligné ce scientifique, le défi ne consiste toutefois pas seulement à planter des arbres. Il s'agit de choisir "le bon arbre au bon endroit" tout en considérant les besoins à court et long terme des arbres et de la population. De plus en plus, il faut maintenant aussi prendre en compte "les effet du changement climatique, de même que les dimensions écologiques, sociales, culturelles et économiques", a-t-il affirmé.
En plus de revégétaliser le pays avec des espèces indigènes, les autorités prévoient de remplacer certaines espèces étrangères telles que l'eucalyptus, importé depuis l'Australie dans les années 1890. Selon le ministère de l'Agriculture éthiopien, le projet global Green Legacy va nécessiter des centaines de milliers de volontaires pour un coût estimé à 330 millions d'euros.