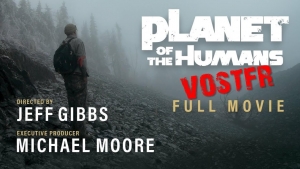Après des mois de temps exceptionnellement chaud et sec, des centaines d’incendies ont carbonisé une superficie de l’Australie dépassant les 10 millions d’hectares, soit trois fois la surface de la Belgique. Des milliers de maisons ont été détruites et on déplore, selon un dernier bilan, une trentaine de morts.
Outre les dégâts incommensurables causés à la faune et à la flore, les feux émettent également une quantité massive de gaz et de particules dans l’atmosphère. Vu de l’espace, le spectacle est impressionnant : en deux semaines, depuis le 31 décembre 2019, les fumées portées par les vents ont fait le tour de la Terre et sont revenues près de leur point de départ, dans la région de Sydney.
L’atmosphère sous surveillance
Notre équipe surveille la composition de l’atmosphère en continu depuis 13 ans, grâce à IASI, un instrument exceptionnel embarqué à bord des satellites Metop. Ces satellites météorologiques surveillent l’atmosphère depuis une orbite polaire, à environ 800 km d’altitude ; ils passent matin et soir à chaque endroit du globe.
IASI est ce qu’on appelle un spectromètre à transformée de Fourier, enregistrant le rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre. Quand ce rayonnement traverse l’atmosphère, il interagit avec les molécules qui se trouvent sur le trajet, entre le sol et le satellite. Si le ciel est clair, l’analyse du signal reçu fournit une information des concentrations des gaz à l’endroit de la mesure ; si le ciel est nuageux, l’observation n’est possible qu’au-dessus du nuage.
Comme chaque gaz possède une signature spécifique, un peu comme un code barre pour un article de supermarché, les passages successifs du satellite permettent de surveiller, depuis l’espace, les gaz qui se déplacent autour du globe. Les trois instruments IASI fournissent plus de 3,5 millions d’observations chaque jour. Si vous mettez 10 minutes à parcourir cet article, ce sont plus de 25 000 observations à analyser qui se seront accumulées pendant ce laps de temps…
Des feux partout
Nous disposons désormais d’une base de données colossale qui nous permet de suivre, au jour le jour, à la fois les émissions de gaz observées de manière fréquente ou récurrente (pics de pollution, gaz à effet de serre, surveillance de la couche d’ozone en Antarctique) et les évènements qui se produisent à des endroits et des moments inattendus, comme les éruptions volcaniques ou les grands feux.
Pour les méga-incendies, les cartes des six derniers mois montrent une situation exceptionnelle, avec différentes régions du globe en proie aux flammes durant des semaines : outre les feux récurrents dans les régions qui pratiquent l’agriculture sur brûlis – Afrique et Indonésie tout particulièrement –, les observations quotidiennes montrent des fumées consécutives aux feux dévastateurs de 2019 qui ont eu lieu dans les régions boréales en juillet-août, en Amazonie entre août et octobre, et en Australie depuis septembre.
Que voit-on par satellite ?
La composition de l’air que nous respirons est bien connue des scientifiques : il s’agit essentiellement d’azote et d’oxygène (à 99,9 %) ; avec des concentrations bien moindres, on retrouve aussi des quantités significatives de gaz comme la vapeur d’eau (H20), le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), les oxydes d’azote (NOx), l’ozone (O3), le monoxyde de carbone (CO), etc. Ils constituent « le fond de l’air » et, comme ils interagissent avec la radiation infrarouge, ils sont visibles sur les données du satellite.
Ce qu’on peut observer depuis l’espace, c’est qu’en plus des cendres et du carbone-suie (particules), les feux de végétation émettent un cocktail de gaz toxiques qui peut varier en fonction du type de végétation brûlée (forêt, savane, toundra, broussailles, etc.). Ces fumées composées de gaz et de particules se déplacent ensuite au gré des vents, plus ou moins loin selon leur persistance dans l’atmosphère et leur altitude d’injection.
Les panaches de fumée sont principalement composés de CO2 et de CO – deux gaz directement lié à la combustion – et de particules (suies). Une multitude d’autres composés sont aussi présents (HCN, NH3, composés organiques volatiles, etc.), mais certains restent moins longtemps dans l’atmosphère et ne sont vus du satellite que tout près des feux.
À quelle altitude s’échappent les fumées ?
Durant la première semaine de janvier 2020, une succession exceptionnelle de « nuages de feu » a été observée. Les scientifiques utilisent le terme pyrocumulonimbus pour désigner ces nuages gigantesques qui s’élèvent parfois au-dessus des panaches de fumée des feux ou des éruptions volcaniques.
La formation de pyrocumulus requiert que les feux brûlent suffisamment pour créer un courant d’air surchauffé qui s’élève très rapidement. Lorsque l’air chaud monte et se répand, il se refroidit, ce qui entraîne la condensation de la vapeur d’eau et la formation de nuages. Dans certaines conditions, de puissants courants ascendants peuvent créer des nuages qui s’élèvent sur plusieurs kilomètres et se transforment en véritables orages lorsqu’ils atteignent le sommet de la troposphère – transformant un pyrocumulus en pyrocumulonimbus. Ces orages présentent de sérieux risques pour les pilotes d’avion en raison des fortes turbulences, et peuvent rendre les feux encore plus incontrôlables en créant des « tornades de feu ».
Les nuages de feu ont fait monter les fumées à des hauteurs inhabituelles dans l’atmosphère, comme l’a confirmé le satellite Calipso qui a observé des particules liées aux feux entre 15 et 19 kilomètres, notamment le 6 janvier 2020. À cette altitude, les suies sont transportées très efficacement par le courant-jet (jet-stream) – un vent rapide et confiné qui se déplace d’ouest en est. Il s’agit d’une sorte de « couloir aérien » qui explique que pour un vol Paris-New York l’aller prendra 45 minutes de plus que le retour !
Jusqu’où les panaches de feux peuvent-ils aller ?
Un élément de compréhension important est que tous les gaz n’ont pas la même persistance dans l’atmosphère. Pour un gaz donné, celle-ci dépend de sa capacité à réagir avec d’autres gaz (réaction chimique), à être détruit par le rayonnement solaire (réaction photochimique) ou à se redéposer sur le sol (dépôt sec ou humide).
Certains gaz sont très réactifs et sont détruits en quelques secondes ou quelques minutes. Même s’ils sont émis en concentration élevée, ils sont détruits quasi instantanément et sont, pour la plupart, invisibles depuis l’espace. D’autres gaz restent quelques heures ou quelques jours. Ils sont détectables par les satellites mais uniquement à proximité immédiate de la source d’émission. Certains gaz, quant à eux, persistent dans l’atmosphère plusieurs mois ou plusieurs années, ce qui leur permet d’être transportés loin de leur source d’émission.
Selon les vents dominants, faire le tour de la Terre leur prendra entre deux et quatre semaines, ce qui est facilement observable par nos instruments puisque nous disposons des cartes deux fois par jour. C’est le cas du CO (dont la durée de vie est d’environ deux mois) et du CO2 qui reste plusieurs dizaines d’années dans l’atmosphère. Mais l’équateur agit comme une sorte de barrière dynamique qui empêche les masses d’air de l’hémisphère Nord de se mélanger avec celles de l’hémisphère Sud (et vice et versa).
Les gaz à effet de serre constituent une exception car leur durée de vie de plusieurs années, parfois plusieurs dizaines d’années, leur permettent à long terme de se répartir partout sur la planète.
En ce qui concerne les fumées australiennes, elles ont donc circulé à latitude constante, partant de la région de Sydney puis passant par l’Amérique du Sud, en survolant des parties de l’Antarctique, puis en revenant dans la zone d’émission par l’ouest.
Les cendres et le monoxyde de carbone n’atteindront donc pas l’hémisphère Nord et seront dissipés avant. En revanche, le CO2 se répartira partout et participera au réchauffement climatique global dans des proportions significatives.
D’après des estimations réalisées mi-janvier, 400 millions de tonnes de dioxyde de carbone auraient été rejetées dans l’atmosphère par les feux australiens, soit presque l’équivalent des 445 millions de tonnes rejetées par la France durant toute l’année 2018…
Cathy Clerbaux: Directrice de recherche au CNRS, laboratoire LATMOS,
Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), Sorbonne Université
Pierre Coheur : Professeur, chimie de l’environnement, Université Libre de Bruxelles