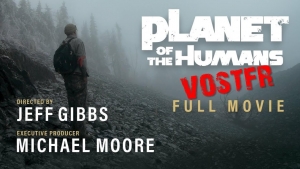Des langues locales massivement parlées mais exclues du système éducatif
Dans un pays comme le Sénégal, – où il existe 22 langues locales codifiées : wolof, pulaar, sereer, joola, màndienka, sóninké, hasaniya, balant, mànkaañ, noon, mànjaku, mënik, oniyan, saafi-saafi, guñuun, laalaa, kanjad, jalunga, ndut, bayot, paloor et womey –, l’arrivée de textes internationaux et la diffusion de l’information posent la question de savoir dans quelle(s) langue(s) les populations doivent être informées.
Tandis que le français, langue officielle, de l’administration, des systèmes éducatif et judiciaire, n’est compris que par environ 20 % de la population, le wolof, comme véhiculaire principal, pratiqué et compris par plus de 70 % de la population, ne bénéficie d’aucun statut officiel dans la gestion du quotidien des populations. D’où les revendications pour le développement d’un multilinguisme langues locales/langues étrangères dans le système éducatif qui se font aujourd’hui de plus en plus pressantes.
Pour rappel, en 2015, les Nations unies ont adopté 17 Objectifs de développement durable (ODD), dans le but de « transformer notre monde [et de l’emmener] vers un développement durable à l’horizon 2030 », avec pour ambition de ne laisser personne de côté dans cette quête.
Ces objectifs ont été traduits en wolof et diffusés en juillet 2016. Nous avons ainsi pu observer cette campagne d’affichage, en français et en wolof, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), l’université publique la plus importante du pays, avec près de 90 000 étudiant·e·s. Elle offre la particularité d’être ouverte aux populations et de constituer un lieu de passage. Il y avait donc là une volonté manifeste d’informer, d’éduquer et d’impliquer les étudiant·e·s, et au-delà.
C’est ce même souci d’appropriation par les populations de textes officiels qui avait prévalu en 2008-2009 à la traduction en wolof et à la diffusion de la « Charte de gouvernance démocratique » issue des assises nationales.
Relever le défi des traductions approximatives en langues locales
À travers des exemples tirés des ODD et de la « Charte de gouvernance démocratique », le but ici est d’observer le possible décalage entre l’idée véhiculée par le texte en français et celle exprimée par la traduction en wolof, ainsi que la réception des messages auprès des populations.
Sur le campus de l’Université, l’affichage en français exposait ainsi les 17 objectifs accompagnés de pictogrammes et de slogans.
En revanche, pour le wolof, seuls les 17 pictogrammes et slogans avaient été affichés.
Si l’on examine l’objectif 1, on perçoit d’emblée un décalage entre l’information donnée dans les deux langues.
En français, on dispose d’une glose – « Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde »– et d’un slogan : « Pas de pauvreté ». En wolof, seul le slogan « Amul ñàkk » accompagne le pictogramme. La traduction en wolof respecte bien la construction nominale française dans le slogan : « pas de » est traduit par « Amul » qui signifie ici « il n’existe pas » ; « pauvreté » est rendu par « ñàkk ». Cette traduction mot à mot du slogan français est peut-être compréhensible, mais en wolof elle finit par nier la pauvreté. L’expression « Amul ñàkk » ne fixe pas un objectif à atteindre, comme indiqué dans la glose en français, mais elle exprime une simple négation de la pauvreté. Si la traduction en wolof avait été faite avec l’objectif « d’éliminer la pauvreté… », il n’aurait pas fallu utiliser « Amul », mais un verbe impliquant « une action allant contre… ».
De la même façon, pour l’objectif 2, la glose dit : « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » ; et le slogan retient : « Faim “zéro” ».
En wolof, le slogan dit : « Xiif dëddu », littéralement « la faim (xiif) s’en va (dëddu) ». Ainsi, la construction en wolof ne rend pas compte de la volonté manifestée par le slogan, à savoir lutter pour « éliminer la faim… », avec la collaboration et l’implication des populations.
Dans ces deux exemples, en se fondant sur le texte en wolof, la compréhension que l’on peut avoir des objectifs est très différente du contenu en français : même si l’initiative est à saluer, on observe que dans le passage au wolof, l’information est tronquée, dénaturée, voire incompréhensible.
Multilinguisme des échanges, unilinguisme de la rédaction
En 2008-2009, dans un contexte de dialogue politique bloqué, l’opposition sénégalaise et la société civile ont initié des consultations citoyennes dénommées « les Assises nationales du Sénégal », qui ont duré une année entière. La « Charte de gouvernance démocratique », qui en a découlé a été rédigée en français et traduite dans plusieurs langues nationales, dont le wolof.
Arrêtons-nous sur la première phrase du préambule et le premier principe de la charte.
En français : « Pour un Sénégal nouveau »
En wolof : « Ngir taxawal Senegaal bu bees »
Littéralement : « Pour ériger un Sénégal qui est nouveau »
En français, la formule inaugurale comprend à la fois le pays concret mais aussi la Nation avec tout ce que cela comporte d’abstrait : culture, valeurs, langues, liberté ou sens de l’appartenance, etc. En wolof, le choix du terme « taxawal » focalise sur les aspects concrets (à l’exemple d’un monument, d’une statue, d’un quartier ou d’une maison à ériger ou à bâtir), en excluant toute la dimension abstraite.
En français, ce qui est à renouveler, c’est – entre autres choses – la démocratie, la politique linguistique, la gestion des deniers publics, le statut de l’opposition ou la politique industrielle, etc., tout ce qui a fait le Sénégal et qui est en train de disparaître, ou d’être perdu. En wolof, il s’agit simplement d’une construction nouvelle.
Autre exemple :
En français : « Le Sénégal est une République laïque et démocratique »
En wolof : « Senegaal réewu demokaraasi la, mu teqale doxalinu nguur ak mbiru diine » ;
Littéralement : « Le Sénégal est un pays de démocratie, il sépare la gestion du pouvoir des affaires religieuses ».
La liberté d’intervertir l’ordre des adjectifs « laïque » et « démocratique » pour les besoins de la construction en wolof est à saluer. La traduction dit d’abord que le Sénégal est une démocratie avant de proposer une explicitation du terme « laïque » (« sépare la gestion du pouvoir des affaires religieuses »). La traduction participe ainsi à l’éducation des populations susceptibles de penser, comme bon nombre de femmes et d’hommes publics (du milieu politique ou des médias…), que les termes « laïque » ou « laïcité » renvoient à la non-croyance en Dieu, à la négation de Dieu.
Ces « consultations citoyennes » se sont déroulées, la plupart du temps, en langues nationales mais aussi en français. Il est curieux de constater que La Charte a été rédigée en français, puis traduite en langues locales. On était plutôt en droit d’attendre qu’au multilinguisme des échanges corresponde un multilinguisme dans la rédaction de la charte.
Les arguments aujourd’hui avancés, au Sénégal, en faveur d’un français qui serait « unificateur » au sein d’une variété linguistique conçue comme « complexe » ne peuvent pas tout justifier.
La nécessité de réhabiliter les langues nationales
Comme l’avait dit Arame Fall en 1990 (“Les politiques linguistiques africaines : tendances générales et perspectives” in Des langues et des villes, Didier érudition, p. 71), il est certainement temps pour nos États, indépendants depuis plus d’une cinquantaine d’années, de :
« […] choisir, avec tout ce que cela peut comporter de douloureux […] la mise en œuvre d’une politique linguistique qui donne aux langues nationales la place qui leur revient dans la gestion de la chose publique… Chaque État [devra] donner un statut officiel à la (ou aux) langue(s) qu’il s’est choisie(s) souverainement et définir le statut des langues retenues entre elles – en cas de plurilinguisme – et par rapport au français dans l’espace francophone, [par exemple…] ».
Déjà, en 1981, les États généraux de l’Éducation et de la Formation avaient mis l’accent sur la nécessité de réhabiliter les langues nationales. Depuis lors, des efforts importants ont été fournis dans le sens de la codification de toutes les langues du pays par la Direction de l’Alphabétisation et des Langues nationales. À l’Université, des recherches importantes ont aussi permis l’utilisation des avancées de l’informatique pour la graphisation et la présence sur Internet des langues locales. Par ailleurs, des initiatives ont été développées en faveur de l’exploitation des méthodologies et technologies développées ces dernières années en matière de constitution de dictionnaires, de bases de données lexicales et terminologiques.
Tout ce processus inévitable de promotion des langues locales sénégalaises jouera pleinement son rôle quand il aidera à outiller ces langues afin de leur permettre notamment d’intégrer le système éducatif formel et d’avoir une participation plus active aux échanges politico-administratifs officiels. Il est certain que la mise en place d’une institution d’enrichissement et de régulation terminologique serait indispensable…
Au-delà du problème de traduction, c’est bien une question de souveraineté nationale et de droit à l’information qui est soulevée ici.
Mame Thierno Cissé
Enseignant-chercheur, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Gabrielle Le Tallec
Enseignante-chercheuse, Université Sorbonne Paris Nord – USPC