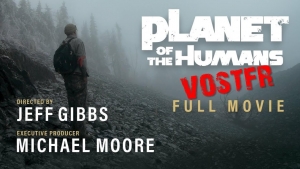"Il faut bien s'en débarrasser, autant le faire de façon intelligente", dit la septuagénaire, qui a reçu en échange de ses bouteilles un ticket d'une trentaine de couronnes (3 euros) à faire valoir à la caisse pour un remboursement en liquide ou en bon d'achat.
Avec un taux de recyclage d'environ 97% des bouteilles en plastique, la Norvège est une très bonne élève: elle dépasse avec dix ans d'avance l'objectif fixé par l'Union européenne, à savoir un taux de collecte de 90% en 2029.
Ce chiffre plafonne péniblement à 60% en France, où un éventuel système de consigne vient d'être repoussé à 2023.
Ce système est pourtant la clé du succès du pays nordique: il consiste à faire payer au consommateur quelques centimes supplémentaires pour une boisson embouteillée, surcoût qui lui est remboursé lorsqu'il ramène le contenant vide.
"En fait, les consommateurs achètent le produit mais empruntent son emballage", explique Kjell Olav Maldum, directeur d'Infinitum, société créée par les producteurs et les distributeurs pour gérer la consigne.
Le concept est entré dans les moeurs au point que la langue norvégienne s'est dotée d'un verbe --å pante (prononcez: o paanteu)-- pour désigner le fait d'aller déposer à la consigne.
Bonus: les machines laissent aux consommateurs le choix de réinvestir la somme qui leur est due dans une loterie finançant une bonne cause.
Rubik's cubes insolubles
Plus de 1,1 milliard de bouteilles plastiques et canettes en aluminium ont été restituées en 2018 dans les machines déployées dans les supermarchés ou directement dans les stations-service et autres petits points de vente.
A Fetsund, à une trentaine de kilomètres au nord-est d'Oslo, un ballet incessant de poids lourds déversent des milliers de flacons vides dans le principal centre de traitement d'Infinitum.
Sautillant sur des convoyeurs, les bouteilles d'eau, de jus de fruits et de sodas sont triées, compactées et mises en ballots, formant d'énormes Rubik's cubes multicolores et insolubles appelés à connaître plusieurs vies après recyclage.
Car chaque nouvelle bouteille plastique en Norvège contient environ 10% de matériau recyclé, écologiquement plus correct.
Une proportion que le pays nordique veut accroître avec un projet de taxe dégressive qui encouragerait le recours au plastique recyclé aux dépens du vierge, aujourd'hui moins cher.
Détritus valorisé
"Si vous mettez vos bouteilles dans une machine, elles entrent dans une boucle vertueuse", plaide Harald Henriksen, dirigeant chez Tomra, leader mondial des machines de déconsignation. "Vous pouvez les réutiliser pour fabriquer de nouvelles bouteilles à maintes reprises".
Dans ce modèle d'économie circulaire, ce que l'on considère ailleurs comme un détritus devient une ressource, dont la valeur qu'on lui assigne encourage la collecte et le recyclage.
L'idée a fait de nombreux adeptes.
"Un exemple: la Lituanie où ils avaient un taux de collecte de 34% avant qu'un système de consigne ne soit mis en place. Deux ans plus tard, ce chiffre était déjà passé à 92%", souligne M. Henriksen
Selon Zero Waste Europe, la consigne est "le seul moyen" de respecter la feuille de route tracée par l'UE mais l'ONG environnementale prône un système "mixte" qui reprendrait aussi les bouteilles en verre pour réemploi ainsi que l'extension du principe à d'autres emballages en plastique.
Selon WWF, l'équivalent de quinze tonnes de plastique sont déversées chaque minute dans les océans.
Sans nier le besoin de débarrasser la planète de ce fléau, les professionnels norvégiens estiment que ce matériau --léger, pratique et bon marché-- reste promis à un bel avenir.
"Le problème réside-t-il dans le plastique lui-même ou dans la façon dont nous, consommateurs, nous comportons?", demande M. Maldum. "Le plastique est encore fantastique mais ne le jetons pas dans la nature".