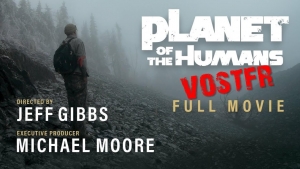L’épidémie de coronavirus Covid-19 en cours, qui a débuté à Wuhan à la fin de l’année dernière, illustre bien la menace que représentent les maladies infectieuses émergentes, non seulement pour la santé humaine et animale, mais aussi pour la stabilité sociale, le commerce et l’économie mondiale.
Or de nombreux indices portent à croire que la fréquence des émergences de nouveaux agents infectieux pourrait augmenter dans les décennies à venir, faisant craindre une crise épidémiologique mondiale imminente. En effet, les activités humaines entraînent de profondes modifications de l’utilisation des terres ainsi que d’importants bouleversements de la biodiversité, en de nombreux endroits de la planète.
Ces perturbations se produisent dans un contexte de connectivité internationale accrue par les déplacements humains et les échanges commerciaux, le tout sur fond de changement climatique.
Il s’agit là des conditions optimales pour favoriser le passage à l’être humain de micro-organismes pathogènes provenant des animaux. Or, selon l’OMS, les maladies qui résultent de telles transmissions comptent parmi les plus dangereuses qui soient.
Identifier les nouvelles menaces
Fièvre hémorragique de Crimée-Congo, virus Ebola et maladie du virus de Marburg, fièvre de Lassa, coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et syndrome respiratoire aiguë sévère (SRAS), Nipah et maladies hénipavirales, fièvre de la vallée du Rift, Zika…
Toutes ces maladies ont en commun de figurer sur la liste « Blueprint des maladie prioritaires », établie par l’OMS en 2018.
Les maladies listées ici sont considérées comme des urgences sur lesquelles doivent se concentrer les recherches. Elles présentent en effet un risque de santé publique à grande échelle, en raison de leur potentiel épidémique et de l’absence ou du nombre limité de mesures de traitement et de contrôle actuellement disponibles.
Cette liste comporte également une « maladie X » : ce terme énigmatique désigne la maladie qui sera responsable d’une épidémie internationale d’ampleur, causée par un pathogène actuellement inconnu. L’OMS ne doute pas qu’elle puisse survenir, et demande donc à la communauté internationale de se préparer en prévision d’un tel scénario catastrophe.
Actuellement, la réponse des autorités de santé publique face à ces maladies infectieuses émergentes consiste à « prendre de l’avance sur la courbe », c’est-à-dire à identifier les facteurs environnementaux susceptibles de déclencher l’émergence. Malheureusement, notre compréhension de la façon dont font surface les nouvelles menaces infectieuses demeure encore limitée.
Mais une chose est sûre, les animaux seront très probablement impliqués dans les prochaines épidémies. Car c’est un autre point commun des maladies de cette liste dressée par l’OMS : toutes peuvent être classées comme des infections virales zoonotique.
Les animaux largement impliqués dans les nouvelles épidémies
Au cours des quatre dernières décennies, plus de 70 % des infections émergentes se sont avérées être des zoonoses, autrement dit des maladies infectieuses animales transmissibles à l’être humain.
Au plus simple, ces maladies incluent un seul hôte et un seul agent infectieux. Cependant, souvent plusieurs espèces sont impliquées, ce qui signifie que les changements de biodiversité ont le potentiel de modifier les risques d’exposition à ces maladies infectieuses liées aux animaux et aux plantes.
On pourrait à ce titre penser que la biodiversité représente une menace : puisqu’elle recèle de nombreux pathogènes potentiels, elle accroît le risque d’apparition de nouvelles maladies.
Pourtant, curieusement, la biodiversité joue également un rôle protecteur vis-à-vis de l’émergence des agents infectieux. En effet, l’existence d’une grande diversité d’espèces hôtes peut limiter leur transmission, par un effet de dilution ou par effet tampon.
La perte de biodiversité augmente la transmission des agents pathogènes
Si toutes les espèces avaient le même effet sur la transmission des agents infectieux, on pourrait s’attendre à ce qu’une baisse de la biodiversité entraîne de façon similaire une baisse de la transmission des agents pathogènes. Or il n’en est rien : ces dernières années, les études montrent de façon concordante que les pertes de biodiversité ont tendance à augmenter la transmission des agents pathogènes, et la fréquence des maladies associées.
Cette tendance a été mise en évidence dans un grand nombre de systèmes écologiques, avec des types hôtes-agents et des modes de transmission très différents. Comment s’explique cette situation ? La perte de biodiversité peut modifier la transmission des maladies de plusieurs façons :
1) En changeant l’abondance de l’hôte ou du vecteur. Dans certains cas, une plus grande diversité d’hôtes peut augmenter la transmission des agents, en augmentant l’abondance des vecteurs ;
2) En modifiant le comportement de l’hôte, vecteur ou parasite. En principe, une plus grande diversité peut influencer le comportement des hôtes, ce qui peut avoir différentes conséquences, qu’il s’agisse d’une augmentation de la transmission ou de l’altération de l’évolution des dynamiques de virulence ou des voies de transmission. Par exemple, dans une communauté plus diverse, le ver parasitaire qui est responsable de la bilharziose (maladie qui affecte plus de 200 millions de personnes dans le monde) a plus de chance de se retrouver dans un hôte intermédiaire inadéquat. Ceci peut réduire la probabilité de transmission future à l’humain de 25 à 99 % ;
3) En modifiant la condition de l’hôte ou du vecteur. Dans certains cas, dans des hôtes à fortes diversités génétiques, les infections peuvent être réduites, voire induire des résistances, ce qui limite de fait la transmission. Si la diversité génétique se réduit parce que les populations diminuent, la probabilité qu’apparaissent des résistances diminue également.
Dans ce contexte, la perte de biodiversité en cours est d’autant plus inquiétante. Les estimations actuelles suggèrent par exemple qu’au moins 10 000 à 20 000 espèces d’eaux douces ont disparu ou sont à risque de disparaître. Les taux de déclins observés actuellement rivalisent avec ceux des grandes crises du passé, telles que celle qui a marqué la transition entre Pléistocène et Holocène, voici 12 000 ans, et qui s’est accompagné de la disparition de la mégafaune, dont le mammouth laineux était un des représentants emblématiques.
Mais la perte de biodiversité n’est pas le seul facteur influant sur l’émergence de nouvelles maladies.
Le changement climatique et les activités humaines
C’est le déplacement de l’empreinte géographique des pathogènes et/ou de l’hôte qu’ils infectent qui conduit à l’émergence de nouvelles maladies infectieuses. À ce titre, l’imprévisibilité croissante du climat mondial et les interactions locales homme-animal-écosystème, de plus en plus étroites dans certains endroits de la planète, jouent un rôle majeur dans l’émergence de nouvelles infections au sein des populations humaines.
Ainsi, l’augmentation des températures moyennes aurait eu un effet significatif sur l’incidence de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, causée par un virus transmis par les tiques, ainsi que sur la durabilité du virus Zika, transmis par les moustiques dans les régions subtropicales et tempérées.
La consommation de viande de brousse et le commerce d’animaux, résultant de la demande croissante en protéines animales, provoquent aussi des changements importants dans les contacts entre les êtres humains et les animaux. Des études ont démontré que les flambées de SRAS et d’Ebola étaient directement liées à la consommation de viande de brousse infectée. En outre, la fièvre de Lassa et les maladies dues aux virus Marburg et Ebola prospèrent en Afrique de l’Ouest et du Centre, où la consommation de viande de brousse est quatre fois supérieure à celle de l’Amazonie, pourtant plus riche en biodiversité.
Autre risque : l’expansion de l’agriculture et de l’élevage. Afin de répondre à la demande toujours croissante des populations humaines, de nouveaux espaces doivent être conquis, en déforestant et en défrichant. Or on sait que cette réaffectation des terres peut déclencher l’émergence des maladies infectieuses, en favorisant les contacts avec des organismes jusqu’ici rarement rencontrés. Ainsi, dans les îles de Sumatra, la migration des chauves-souris fruitières causée par la déforestation dû aux incendies de forêt a conduit à l’émergence de la maladie de Nipah chez les éleveurs et les personnels des abattoirs en Malaisie.
Des émergences inévitables
Les relations entre la biodiversité des espèces hôtes et celle des parasites et microbes pathogènes sont complexes. En modifiant la structure des communautés, tous ces changements environnementaux risquent d’entraîner une modification des schémas épidémiologiques existants.
Dans ce contexte, les populations humaines peuvent se retrouver au contact d’un animal porteur d’un virus capable de les contaminer. Un cycle d’infections peut alors se mettre en place. Il débute par des cas sporadiques de transmission de l’animal à l’être humain, appelé « virus chatter » (« bavardage viral »). Ensuite, à mesure que les cycles se multiplient, l’émergence de la transmission interhumaine devient inévitable.
Une fois l’épidémie déclenchée, la rapidité de réaction est primordiale. Outre les mesures sanitaires de rigueur, lorsque le temps manque pour mener des études épidémiologiques appropriées les modélisations mathématiques peuvent être d’un grand secours pour évaluer rapidement l’efficacité de la prévention, et anticiper l’évolution de la maladie.
Mais appréhender la complexité des interactions entre réservoir naturel, agent pathogène et hôte(s) intermédiaire(s) reste un défi de taille lorsqu’il s’agit d’intervenir rapidement pour arrêter la transmission de la maladie. L’exemple du COVID-19 l’illustre une nouvelle fois : plus de deux mois après les premières infections, les divers maillons animaux de la chaîne de transmission de l’épidémie restent à identifier.
Rodolphe Gozlan: Directeur de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Soushieta Jagadesh: Doctoral Student, Institut de recherche pour le développement (IRD)