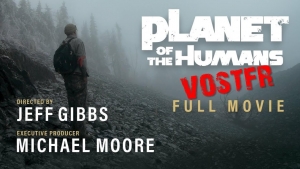La guerre au Yémen transforme depuis cinq ans chaque jour en un défi pour les millions d'habitants de ce pays: comme eux, les animaux du zoo de Sanaa, ne savent pas de quoi demain sera fait.
Dans la capitale, prise en 2014 par les rebelles Houthis, un employé ouvre une grille pour jeter une carcasse d'âne à 31 lions affamés, qui se jettent sur leur déjeuner avant de le dévorer.
Quatre fauves sont déjà morts de faim en 2017, raconte à l'AFP leur gardien, Amin al-Majdi.
"Nous sommes confrontés à une hausse du prix des ânes", soupire-t-il. "Avant, nous abattions trois ou quatre ânes (par jour) pour nos six lions, mais maintenant (qu'ils sont) 31 nous sommes obligés d'en abattre 10 à 12."
A l'instar du reste du pays --où la guerre débutée en 2015 a provoqué la plus grave crise humanitaire au monde et poussé la population au bord de la famine selon l'ONU--, le zoo de Sanaa peine à fournir une nourriture suffisante à ses 1.159 animaux.
Parmi ces derniers, deux léopards arabes, une espèce menacée, se couchent souvent le ventre vide, comme les dizaines de singes qui survivent en grappillant des restes de nourriture lancés par les visiteurs.
- "Bouffée d'air" -
Le zoo de la capitale est pourtant en meilleur état que ceux de Taëz (sud-ouest) et d'Ibb (centre), affirme Kim Michelle Broderick, fondatrice de One World Actors Animal Rescues (OWAP), une ONG basée en France qui collecte des fonds en faveur des zoos yéménites.
A Ibb, les animaux ne sont "pas nourris du tout", dénonce-t-elle. Et quel que soit le zoo, "les cages sont minuscules et les animaux souffrent de traumatismes chroniques."
L'OWAP est l'une des rares organisations internationales de défense de la cause animale à intervenir au Yémen, où elle distribue des rations alimentaires d'urgence et de l'eau aux animaux, mais assure aussi des soins vétérinaires aux chevaux, aux animaux de ferme et aux animaux errants.
Outre l'envolée des prix pour une carcasse d'âne, la baisse du nombre de visiteurs joue sur les finances du zoo de Sanaa.
"Notre seul revenu provient de la vente des billets", explique à l'AFP le directeur adjoint du zoo, Mohammed Abou Aoun.
Selon lui, la vente de tickets d'entrée rapporte entre 2 et 3 millions de riyals (3.000 à 4.500 euros) par mois, ce qui est insuffisant pour nourrir les animaux et payer les employés.
Pour Tawheed al-Thahbi, un visiteur du zoo, le lieu reste pourtant l'un des rares endroits à offrir un peu d'évasion à une population épuisée par des années de conflit.
"Le zoo est devenu la seule bouffée d'air frais. Nous ne voyons que destruction, guerre et agression", confie-t-il à l'AFP.
Des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées et des millions ont été déplacées par le conflit au Yémen.
© 2020 AFP