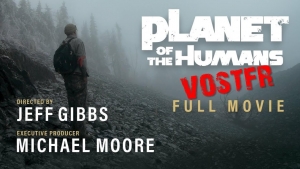Ioane Teitiota, un citoyen de Kiribati qui demandait l’asile à la Nouvelle-Zélande depuis des années, aurait bien pu devenir le premier réfugié climatique du monde. Le 24 janvier dernier, le Comité des droits de l’homme de l’ONU (« le Comité ») a soutenu le refus opposé à sa demande par la Cour suprême de Nouvelle-Zélande, observant que la situation de M. Teitiota ne représentait pas un danger imminent ni une atteinte réelle à ses droits fondamentaux ; mais le Comité a également estimé que les personnes fuyant les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles ne devraient pas être renvoyées dans leur pays d’origine (le principe de « non-refoulement ») si leurs droits humains fondamentaux s’en trouvaient menacés.
Avant de revenir sur cette décision qualifiée d’historique et sur ses conséquences potentielles, rappelons brièvement les faits, la fonction du Comité ainsi que la définition d’un réfugié et les obligations étatiques de non-refoulement dans le contexte du droit international.
Le changement climatique aux Kiribati
M.Teitiota, de l’archipel des Kiribati, s’est expatrié en Nouvelle-Zélande d’où il demandait l’asile depuis 2007, arguant que le changement climatique et la montée des eaux rendaient la situation sur l’atoll de Tarawa de l’archipel intenable et dangereuse.
L’archipel des îles Kiribati compte parmi les plus exposés à la montée des eaux. Il est menacé de disparition dès 2050 selon une estimation du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Pour M. Teitiota, l’archipel pourrait même devenir inhabitable dans les dix à quinze prochaines années puisque les conséquences de la montée des eaux incluent entre autres la salinisation, ce qui entraîne la raréfaction de l’eau potable, la pollution, la destruction des récoltes, des inondations fréquentes et une diminution du terrain habitable créant des conflits souvent violents entre communautés.
En 2015, au terme d’un long processus juridique, les tribunaux de Nouvelle-Zélande ont finalement tous rejeté la demande d’asile de M. Teitiota et l’ont ainsi contraint à retourner aux Kiribati avec sa famille. Il s’est alors tourné vers le Comité des droits de l’homme pour demander un arbitrage, alléguant que la Nouvelle-Zélande avait enfreint l’articles 6 (droit à la vie) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le Pacte »).
Le Comité des droits de l’homme de l’ONU : observateur du Pacte
Le Comité des droits de l’homme des Nations unies est un organe composé de 18 experts indépendants qui surveillent la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États parties.
De manière générale, le Comité examine les rapports que sont tenus de présenter les 172 États parties sur la mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte. Il fait ensuite part de ses préoccupations et de ses recommandations à l’État partie sous la forme d’observations finales.
Le premier Protocole facultatif du Pacte, ratifié quant à lui par 116 États – dont la Nouvelle Zélande –, permet également au Comité d’examiner des plaintes individuelles de particuliers tels que M. Teitiota qui s’estiment victimes d’une violation d’un ou de plusieurs droits reconnus par le Pacte, une fois tous les recours juridiques épuisés au niveau domestique.
Les observations données par le Comité dans ses rapports étatiques ou dans le cadre des procédures de plaintes individuelles ne sont pas juridiquement contraignantes en soi, bien qu’elles imposent une obligation pour les États parties de s’y conformer de bonne foi.
Ce que sont et ne sont pas les réfugiés
L’impact des facteurs environnementaux et des catastrophes résultant du changement climatique sont reconnus comme pouvant avoir « des effets complexes sur les pays, les communautés, le bien-être des individus et leur capacité à jouir et à exercer leurs droits ».
Cependant, ni le droit international ni la décision du Comité ne parlent de « réfugié climatique », et la raison est simple. Les personnes déplacées pour des raisons climatiques ne semblent pas pouvoir être reconnues comme réfugiées selon les termes de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (dite Convention de Genève) puisqu’un réfugié est une personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
La Convention de Genève et son protocole sont les instruments principaux de droit international définissant à la fois ce qu’est un réfugié, quels sont ses droits et enfin quelles sont les obligations des États signataires à son égard.
Bien que les cinq critères énoncés dans la définition ci-dessus semblent exhaustifs, d’autres instruments régionaux ainsi que la pratique de certains États ont permis d’élargir cette définition afin de l’adapter aux conflits modernes. En somme, de nos jours, sont généralement considérés comme réfugiés les personnes fuyant des conflits armés. Concernant ceux fuyant les effets du changement climatique, cela semble pour l’instant plus délicat.
Un des principes essentiels de la Convention de Genève est celui voulant que les réfugiés ne soient pas expulsés ni renvoyés vers une situation où leur vie et leur liberté seraient menacées : c’est le principe de non-refoulement. Celui-ci est donc ancré dans le droit international d’asile mais également dans le droit humanitaire et le droit coutumier. Il est en particulier inscrit dans l’article 6 du Pacte, et ainsi protège non seulement les réfugiés mais tous ceux pouvant démontrer que leur expulsion ou renvoi dans leur pays d’origine constituerait une menace réelle et personnelle pour leur vie et leur liberté. Cependant, la barre reste très haute.
Ce que pourrait être un réfugié climatique
Le Comité a ainsi estimé que la situation personnelle de M. Teitiota et de sa famille était insuffisante pour renverser la décision de la Cour suprême néo-zélandaise, et que celle-ci n’avait donc pas porté atteinte au principe de non-refoulement en renvoyant la famille Teitiota aux îles Kiribati en 2015.
Interrogé par les auteurs pour cet article, professeur Gentian Zyberi directeur du Centre norvégien des droits de l’homme et membre du Comité des droits de l’homme a ainsi expliqué :
« Il est très difficile de constituer une opinion contraire à la décision des tribunaux de Nouvelle-Zélande. Au vu des faits et de la loi, le jugement n’est ni erroné, ni arbitraire, ni ne viole les droits fondamentaux de M. Teitiota. »
Cependant, lorsque les risques d’inhabitabilité deviennent imminents, le Comité a observé qu’il pourrait être illégal pour les gouvernements de renvoyer des personnes dans des pays où les effets du changement climatique les exposent à des phénomènes mettant leur vie en danger (article 6 du Pacte) ou dans lesquels elles courent un risque réel de subir des traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 7).
Bien que la catégorie de « réfugié climatique » n’existe pas encore aux yeux du droit international et qu’en conséquence, il n’existe pas de « seuil minimum » d’éligibilité, les personnes fuyant les effets néfastes du changement climatique et l’impact des catastrophes, que celles-ci soient soudaines ou lentes à se manifester, pourraient avoir des raisons valables de demander le statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève ou d’autres instruments régionaux relatifs aux réfugiés. Pour le Comité, il est nécessaire que les évidences scientifiques soient examinées au cas par cas afin d’en tirer les conclusions légales qui s’imposeront.
Les tribunaux néo-zélandais avaient eux-mêmes au préalable estimé que les dégradations environnementales pourraient être interprétées comme répondant aux critères de définition d’un réfugié selon la Convention de Genève.
Ainsi, en pratique, l’importance des efforts nationaux et internationaux visant à contrer le changement climatique est un élément clé de la décision du Comité. Comme l’explique toujours le professeur Zyberi :
« Le Comité reconnaît au vu des évidences présentées que Tarawa pourrait bel et bien devenir inhabitable d’ici dix à quinze ans parce que les conditions se détériorent. Deux choses peuvent arriver dans cet intervalle. D’abord, il est possible que les autorités nationales ou internationales trouvent quelque solution en mettant en place des mesures qui retarderaient ou enrayeraient le processus de montée des eaux et ses conséquences. Ou alors, il est possible que la situation se détériore complètement et alors une personne qui s’exilerait dans une autre juridiction pour demander l’asile ne pourrait pas être retournée aux Kiribati selon la règle du non-refoulement. Tous les habitants des Kiribati seraient alors potentiellement dans cette situation. »
D’où l’importance de trouver des solutions structurelles – en particulier pour les petits États du Pacifique, par le biais de la coopération régionale et internationale entre les États, ou par celui d’une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU. En outre, il s’agit non seulement de contrer les effets du changement climatique par le développement de politiques environnementales, mais également de penser la relocalisation des futurs déplacés.
L’Australie, prochain pays à faire face à ses responsabilités climatiques devant le Comité ?
Si le Comité reconnaît que les politiques environnementales des Kiribati témoignent que les autorités nationales cherchent à remédier aux causes et effets du changement climatique, en 2019 il a reçu une communication des communautés aborigènes du Détroit de Torrès (nord de l’Australie) et de leurs avocats affirmant que le réchauffement climatique menace leur survie et que l’inaction des autorités australiennes constitue à ce titre une violation de leurs droits humains. Plus précisément, ils estiment que leur droit à la vie, à une vie de famille et à la culture garantis par le Pacte sont directement menacées par les politiques pro-charbon du gouvernement australien.
Bien que cette plainte soit présentement au stade d’admissibilité devant le Comité, elle a été qualifiée de « potentiellement révolutionnaire » par le professeur John Knox, premier rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme et l’environnement. En effet, en vertu du Pacte et selon une observation du Comité, la responsabilité étatique de protection des populations dépend, entre autres, « des mesures prises par les États parties pour préserver l’environnement et le protéger contre les dommages, la pollution et les changements climatiques résultant de l’activité des acteurs publics et privés ».
Même si le Comité prend en compte la plainte des habitants du Détroit de Torrès, sa décision ne pourra pas être légalement contraignante. Mais elle participerait à faire pression sur le gouvernement australien, de la même manière que le cas de M. Teitiota rappelle à la communauté internationale que le temps d’agir, et d’agir ensemble… c’était déjà hier.
Camille Malafosse: Doctorante, Centre Kaldor de droit international pour les réfugiés, UNSW
Domenico Zipoli: Doctorant au Centre norvégien pour les droits de l'homme, University of Oslo








![[Burkina Faso] Agro écologie : ces femmes de Korsimoro qui nourrissent la terre pour se nourrir](/media/k2/items/cache/f8f336d27957a1b2f13b2daec1d1b4b0_Generic.jpg)