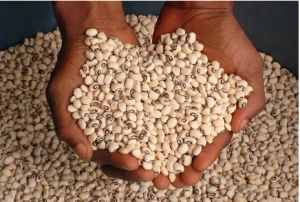Au moment où l’Australie est en feu, Siemens a signé un contrat pour équiper l’une des plus grandes mines de charbon dans le pays, celle de Carmichael développé par l’indien Adani. Mis sous pression par la jeunesse écologiste allemande pour quitter le projet, le PDG Joe Kaeser assure qu’il n’a appris que tardivement l’existence de ce contrat et qu’il est trop tard pour revenir en arrière.
L’un des projets les plus controversés au monde est celui de la mine de charbon de Carmichael en Australie, construite et opérée par l’indien Adani. Cet immense projet de deux milliards de dollars fait recours à de nombreux sous-traitants de la construction et de l’ingénierie. Au rang de ceux-ci, on trouve l’allemand Siemens. L’entreprise doit développer les voies de chemin de fer qui conduiront la production des 27 millions de tonnes de charbon annuelles vers les terminaux d’exportation du Queensland.
Le contrat, signé le 10 décembre, alors que l’Australie était déjà en feu sous l’effet des sécheresses accentuées par le changement climatique, est très mal passé outre-Rhin. De nombreuses voix se sont élevées pour protester et une pétition a été signée par 57 000 citoyens. Vendredi 10 janvier, le mouvement "Fridays for Future" (Vendredis pour le futur), a organisé des manifestations contre Siemens dans une trentaine de villes allemandes.
Dans la foulée, le conseil d’administration de l’industriel s’est réuni pour étudier son positionnement. Mi-décembre, le PDG Joe Kaeser avait promis cet examen après avoir assuré qu'il n'était pas au courant du contrat avec Adani, "probablement compte-tenu de la modestie de celui-ci". "Mais peut-être que j'aurais dû", a-t-il ajouté. À l’issue de la réunion, Joe Kaiser a pourtant annoncé que Siemens n'y renoncerait pas.
Tenir ses promesses
"Nous avons évalué toutes les options et avons conclu que nous devons remplir nos engagements contractuels", assure-t-il. "Il existe une responsabilité fiduciaire juridiquement contraignante pour exécuter ce contrat de signalisation ferroviaire", justifie-t-il. Avant d’ajouter : "Si cela avait été ma propre entreprise, j’aurais agi différemment". "Bien que j'aie beaucoup d'empathie pour les questions environnementales, je dois équilibrer les différents intérêts des différentes parties prenantes", précise-t-il dans un communiqué.
"Tenir nos promesses est la priorité absolue de Siemens", insiste-t-il. Si l’obligation commerciale est réelle, la pénalité financière aurait été faible étant donné que le contrat ne s’élève "qu’à" 18 millions de dollars, à mettre en regard du chiffre d’affaires de 87 milliards de dollars du groupe en 2018. En tout cas, d’autres ingénieristes n’ont pas hésité à quitter l’aventure. Selon les données de Market Forces, "la pression publique a permis jusqu'à présent de pousser plus de 60 entreprises a refusé toute implication avec Adani".
Une Assemblée générale tendue en prévision
Ainsi l’Américain Aecom explique avoir démobilisé son personnel après avoir remis ses premiers plans à Adani. L’Australien Cardno témoigne également en ce sens : "Adani a été très controversé, non seulement en externe, mais également avec le personnel et les autres clients de l'entreprise (…). Nous avons décidé de ne plus travailler sur Adani …". Au-delà des ingénieristes, 16 assureurs et 67 banques refusent désormais de s’impliquer dans le projet, comme Allianz, Axa, Barclays, BNP Paribas, Crédit Suisse, Generali, Munich Re…
Ne pas suivre ce mouvement est une énorme erreur pour Siemens, selon Julien Vincent, directeur de Market Forces. "Si le conseil d'administration de Siemens pense que c'est la fin de l’histoire, ils se trompent. Siemens fera face à une énorme opposition publique lors de son Assemblée générale le 5 février et devra expliquer à ses actionnaires pourquoi faire partie d'un des projets les plus risqués au monde est dans le meilleur intérêt de l'entreprise".
Pour apaiser les tensions dans son pays, Joe Kayser a offert à la militante écologiste de 23 ans, Luisa Neubauer, d’intégrer le conseil de surveillance de Siemens. La jeune fille, qui se réclame du mouvement lancé par Greta Thunberg, a refusé. Elle argue qu’elle n’aurait pas voix au chapitre : "Je connais le droit des actionnaires. Je n'aurais plus été en position de commenter les activités de Siemens de manière indépendante".